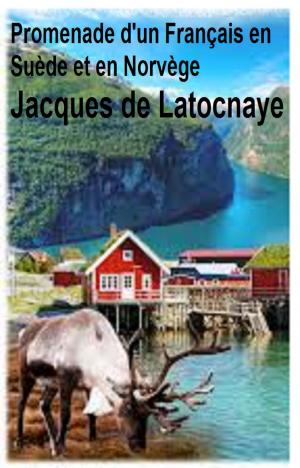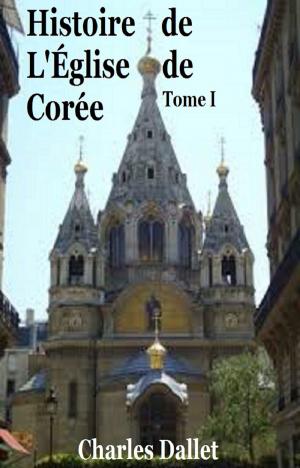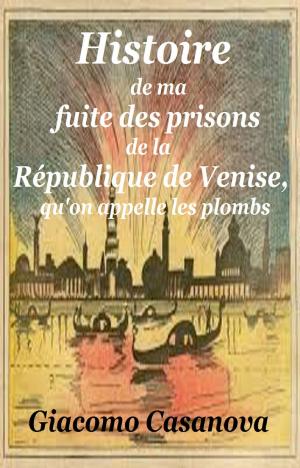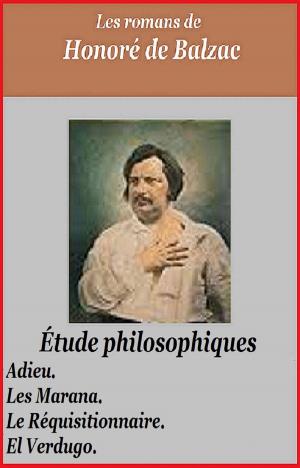| Author: | JULES JANIN | ISBN: | 1230000212892 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | JULES JANIN |
| ISBN: | 1230000212892 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Ainsi l’homme propose et Dieu dispose. J’étais retombé, malgré moi, dans ma philosophie ; tous mes beaux projets de ce matin, l’aspect de ces deux vieillards les avait réduits à néant. Je quittai le Bon Lapin pour n’y plus rentrer, et je revenais sur mes pas, cherchant vainement tout le plaisir que je m’étais promis, quand, au milieu de la route, je rencontrai un voyageur qui marchait sur Paris, comme ferait une armée triomphante ; ce voyageur était un gai compagnon, un insouciant amateur de bon vin et de bonne chère ; on voyait qu’il marchait sans avoir de but, peu inquiet de son gîte du soir et de son repas du lendemain ; son visage était franc et ouvert, le hasard respirait dans toute sa personne. J’ai toujours remarqué que le hasard donnait à un homme qui s’y abandonne franchement, je ne sais quel air de force et de liberté qui fait plaisir à voir : ainsi était le voyageur. Comme je voulais me divertir à tout prix et que d’ailleurs il n’avait pas l’air bien farouche, je me mis à marcher à ses côtés ; c’était un bon homme, il m’adressa la parole le premier :
— Vous allez à Paris, Monsieur ? me dit-il ; en ce cas, vous me montrerez le chemin, car dans toutes ces carrières et parmi toutes ces ronces, je me suis déjà égaré deux fois.
— Volontiers, mon brave ; vous n’avez qu’à me suivre ; nous entrerons à Paris ensemble, bien qu’à vrai dire vous n’ayez pas l’air très-pressé d’arriver.
— Je n’ai jamais eu hâte d’arriver nulle part. Où je suis bien, je reste ; où je suis mal, je reste encore, crainte d’être plus mal. Tel que vous me voyez, véritable héros de grand chemin, j’ai plutôt mené la vie d’un bon bourgeois que d’un chevalier errant. La patience est la vertu qui vient après le courage. Il y a en Italie plus d’un rocher sur lequel je suis resté quinze jours en embuscade, l’oreille tendue, l’œil au guet, la carabine à la main, attendant un gibier qui n’arrivait pas.
— Hé quoi ! Monsieur, seriez-vous par hasard un de ces hardis brigands siciliens dont j’ai entendu faire tant d’agréables récits d’assassinat et de vol, et dont la vie hasardeuse a si bien inspiré Salvator Rosa ?
— Oui, certes, reprit le brigand, j’ai été dans mon temps un de ces hardis Siciliens, comme vous dites, un jovial et courageux bandit, enlevant l’homme et son cheval sur la grande route, aussi habilement qu’un filou français peut voler une misérable bourse dans une foire de village. À ces mots, il baissa la tête et j’entendis un profond soupir.
— Il me semble que vous devez bien regretter cette belle vie, lui dis-je avec l’air du plus grand intérêt.
— Si je la regrette, Monsieur ! vivre autrement ce n’est pas vivre. Rien n’égale, sous le soleil, un digne habitant des montagnes. Figurez-vous un montagnard de vingt ans : un habit vert aux boutons d’or, les cheveux élégamment noués et retenus par un léger filet, une riche ceinture de soie à laquelle ses pistolets sont suspendus, un large sabre qui traîne derrière lui en jetant un son formidable, une carabine brillante comme l’or sur ses épaules ; à son côté, un poignard au manche recourbé ; figurez-vous un jeune bandit ainsi armé, posté sur le haut d’un roc, défiant l’abîme, chantant et se battant tour à tour, tantôt faisant alliance avec le pape, et tantôt avec l’empereur, rançonnant l’étranger comme un esclave, buvant le rosolio à longs flots, faisant les délices des tavernes et des jeunes filles, et toujours sûr de mourir à une potence ou sur un lit de grand seigneur : voilà le bon métier que j’ai perdu !
— Perdu ! Cependant il me semble que vous n’avez pas dû être facile à pendre, et que, si vous vous êtes retiré du métier, c’est que vous l’avez bien voulu.
— Vous en parlez à votre aise, répliqua le bandit ; si comme moi vous aviez été pendu...
— Vous, pendu !
— Oui, j’ai été pendu, et encore pour ma dévotion. J’étais caché dans un de ces impénétrables défilés qui bordent Terracine, quand un beau soir (la lune s’était levée si brillante et si pure !) je me ressouvins que depuis longtemps je n’avais pas offert le dixième de mon butin à la madone. Justement c’était la fête de la Vierge ; toute l’Italie ce jour-là avait retenti de ses louanges, moi seul je n’avais pas eu de prière pour elle ; je résolus de ne pas rester plus longtemps en retard ; je descendis rapidement la vallée, admirant le brillant reflet des étoiles dans le vaste lac, et j’arrivai à Terracine au moment où la nuit était le plus éclairée. J’étais tout entier à la madone ; je traversai la foule des paysans italiens qui prenaient, sur leurs portes, le frais du soir, sans songer que tous les yeux étaient sur moi. J’arrivai à la porte de la chapelle ; un seul battant était ouvert, sur l’autre battant était affichée une large pancarte : c’était mon signalement, et ma tête était mise à prix !
Ainsi l’homme propose et Dieu dispose. J’étais retombé, malgré moi, dans ma philosophie ; tous mes beaux projets de ce matin, l’aspect de ces deux vieillards les avait réduits à néant. Je quittai le Bon Lapin pour n’y plus rentrer, et je revenais sur mes pas, cherchant vainement tout le plaisir que je m’étais promis, quand, au milieu de la route, je rencontrai un voyageur qui marchait sur Paris, comme ferait une armée triomphante ; ce voyageur était un gai compagnon, un insouciant amateur de bon vin et de bonne chère ; on voyait qu’il marchait sans avoir de but, peu inquiet de son gîte du soir et de son repas du lendemain ; son visage était franc et ouvert, le hasard respirait dans toute sa personne. J’ai toujours remarqué que le hasard donnait à un homme qui s’y abandonne franchement, je ne sais quel air de force et de liberté qui fait plaisir à voir : ainsi était le voyageur. Comme je voulais me divertir à tout prix et que d’ailleurs il n’avait pas l’air bien farouche, je me mis à marcher à ses côtés ; c’était un bon homme, il m’adressa la parole le premier :
— Vous allez à Paris, Monsieur ? me dit-il ; en ce cas, vous me montrerez le chemin, car dans toutes ces carrières et parmi toutes ces ronces, je me suis déjà égaré deux fois.
— Volontiers, mon brave ; vous n’avez qu’à me suivre ; nous entrerons à Paris ensemble, bien qu’à vrai dire vous n’ayez pas l’air très-pressé d’arriver.
— Je n’ai jamais eu hâte d’arriver nulle part. Où je suis bien, je reste ; où je suis mal, je reste encore, crainte d’être plus mal. Tel que vous me voyez, véritable héros de grand chemin, j’ai plutôt mené la vie d’un bon bourgeois que d’un chevalier errant. La patience est la vertu qui vient après le courage. Il y a en Italie plus d’un rocher sur lequel je suis resté quinze jours en embuscade, l’oreille tendue, l’œil au guet, la carabine à la main, attendant un gibier qui n’arrivait pas.
— Hé quoi ! Monsieur, seriez-vous par hasard un de ces hardis brigands siciliens dont j’ai entendu faire tant d’agréables récits d’assassinat et de vol, et dont la vie hasardeuse a si bien inspiré Salvator Rosa ?
— Oui, certes, reprit le brigand, j’ai été dans mon temps un de ces hardis Siciliens, comme vous dites, un jovial et courageux bandit, enlevant l’homme et son cheval sur la grande route, aussi habilement qu’un filou français peut voler une misérable bourse dans une foire de village. À ces mots, il baissa la tête et j’entendis un profond soupir.
— Il me semble que vous devez bien regretter cette belle vie, lui dis-je avec l’air du plus grand intérêt.
— Si je la regrette, Monsieur ! vivre autrement ce n’est pas vivre. Rien n’égale, sous le soleil, un digne habitant des montagnes. Figurez-vous un montagnard de vingt ans : un habit vert aux boutons d’or, les cheveux élégamment noués et retenus par un léger filet, une riche ceinture de soie à laquelle ses pistolets sont suspendus, un large sabre qui traîne derrière lui en jetant un son formidable, une carabine brillante comme l’or sur ses épaules ; à son côté, un poignard au manche recourbé ; figurez-vous un jeune bandit ainsi armé, posté sur le haut d’un roc, défiant l’abîme, chantant et se battant tour à tour, tantôt faisant alliance avec le pape, et tantôt avec l’empereur, rançonnant l’étranger comme un esclave, buvant le rosolio à longs flots, faisant les délices des tavernes et des jeunes filles, et toujours sûr de mourir à une potence ou sur un lit de grand seigneur : voilà le bon métier que j’ai perdu !
— Perdu ! Cependant il me semble que vous n’avez pas dû être facile à pendre, et que, si vous vous êtes retiré du métier, c’est que vous l’avez bien voulu.
— Vous en parlez à votre aise, répliqua le bandit ; si comme moi vous aviez été pendu...
— Vous, pendu !
— Oui, j’ai été pendu, et encore pour ma dévotion. J’étais caché dans un de ces impénétrables défilés qui bordent Terracine, quand un beau soir (la lune s’était levée si brillante et si pure !) je me ressouvins que depuis longtemps je n’avais pas offert le dixième de mon butin à la madone. Justement c’était la fête de la Vierge ; toute l’Italie ce jour-là avait retenti de ses louanges, moi seul je n’avais pas eu de prière pour elle ; je résolus de ne pas rester plus longtemps en retard ; je descendis rapidement la vallée, admirant le brillant reflet des étoiles dans le vaste lac, et j’arrivai à Terracine au moment où la nuit était le plus éclairée. J’étais tout entier à la madone ; je traversai la foule des paysans italiens qui prenaient, sur leurs portes, le frais du soir, sans songer que tous les yeux étaient sur moi. J’arrivai à la porte de la chapelle ; un seul battant était ouvert, sur l’autre battant était affichée une large pancarte : c’était mon signalement, et ma tête était mise à prix !