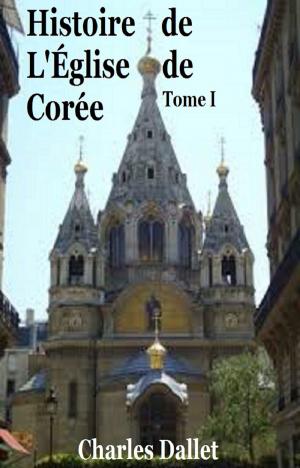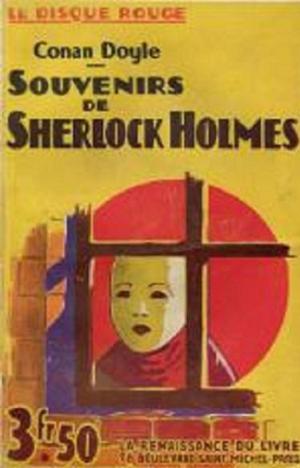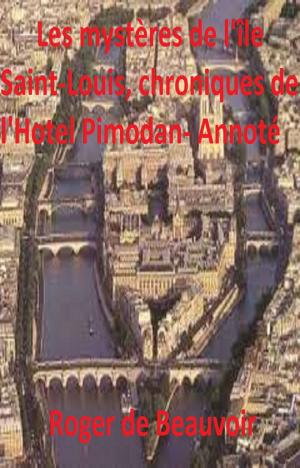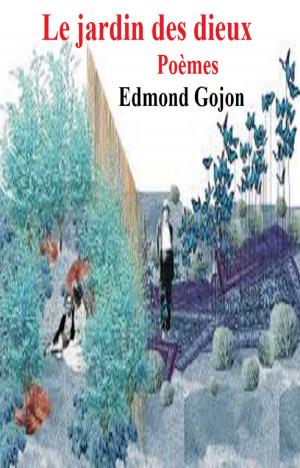| Author: | Marivaux | ISBN: | 1230003201985 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | April 25, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Marivaux |
| ISBN: | 1230003201985 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | April 25, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Avant que de donner cette histoire au public, il faut lui apprendre comment je l’ai trouvée.
Il y a six mois que j’achetai une maison à quelques lieues de Rennes, qui, depuis trente ans, a passé successivement entre les mains de cinq ou six personnes. J’ai voulu faire changer quelque chose à la disposition du premier appartement, et, dans une armoire pratiquée dans l’enfoncement d’un mur, on y a trouvé un manuscrit en plusieurs cahiers contenant l’histoire qu’on va lire, et le tout d’une écriture de femme. On me l’apporta ; je le lus avec deux de mes amis qui étaient chez moi, et qui, depuis ce jour-là, n’ont cessé de me dire qu’il fallait le faire imprimer : je le veux bien, d’autant plus que cette histoire n’intéresse personne. Nous voyons, par la date que nous avons trouvée à la fin du manuscrit, qu’il y a quarante ans qu’il est écrit ; nous avons changé le nom de deux personnes dont il est parlé, et qui sont mortes. Ce qui est dit d’elles est pourtant très indifférent ; mais n’importe : il est mieux de supprimer leurs noms.
Voilà tout ce que j’avais à dire : ce petit préambule m’a paru nécessaire ; et je l’ai fait du mieux que j’ai pu ; car je ne suis point auteur, et jamais on n’imprimera de moi que cette vingtaine de lignes-ci.
Passons maintenant à l’histoire. C’est une femme qui raconte sa vie ; nous ne savons qui elle était. C’est la Vie de Marianne ; c’est ainsi qu’elle se nomme elle-même au commencement de son histoire ; elle prend ensuite le titre de comtesse ; elle parle à une de ses amies dont le nom est en blanc, et puis c’est tout.
Quand je vous ai fait le récit de quelques accidents de ma vie, je ne m’attendais pas, ma chère amie, que vous me prieriez de vous la donner tout entière et d’en faire un livre à imprimer. Il est vrai que l’histoire est particulière, mais je la gâterai si je l’écris ; car où voulez-vous que je prenne un style ?
Il est vrai que dans le monde on m’a trouvé de l’esprit ; mais, ma chère, je crois que cet esprit-là n’est bon qu’à être dit, et ne vaut rien à être lu.
Nous autres jolies femmes (car j’ai été de ce nombre), personne n’a plus d’esprit que nous quand nous en avons un peu ; les hommes ne savent plus alors la valeur de ce que nous disons : en nous écoutant parler, ils nous regardent, et ce que nous disons profite de ce qu’ils voient.
J’ai vu une jolie femme dont la conversation passait pour un enchantement. Personne au monde ne s’exprimait comme elle ; c’était la vivacité, c’était la finesse même qui parlait : les connaisseurs n’y pouvaient tenir de plaisir. La petite vérole lui vint, elle en fut extrêmement marquée : quand la pauvre femme reparut, ce n’était plus qu’une babillarde incommode. Voyez combien auparavant elle avait emprunté d’esprit de son visage ! Il se pourrait bien faire que le mien m’en eût prêté aussi dans le temps qu’on m’en trouvait beaucoup. Je me souviens de mes yeux de ce temps-là, et je crois qu’ils avaient plus d’esprit que moi.
Combien de fois me suis-je surprise à dire des choses qui auraient eu bien de la peine à passer toutes seules : sans le jeu d’une physionomie friponne qui les accompagnait, on ne m’aurait pas applaudie comme on faisait ; et si une petite vérole était venue réduire cela à ce que cela valait, franchement, je pense que j’y aurais perdu beaucoup.
Il n’y a pas plus d’un mois, par exemple, que vous me parliez encore d’un certain jour (et il y a douze ans que ce jour est passé), où dans un repas on se récria tant sur ma vivacité ; eh bien en conscience, je n’étais qu’une étourdie. Croiriez-vous que je l’ai été souvent exprès, pour voir jusqu’où va la duperie des hommes avec nous ? Tout me réussissait, et je vous assure que, dans la bouche d’une laide, mes folies auraient paru dignes des Petites-Maisons, et peut-être que j’avais besoin d’être aimable dans tout ce que je disais de mieux : car à cette heure que mes agréments sont passés, je vois qu’on me trouve un esprit assez ordinaire, et cependant je suis plus contente de moi que je ne l’ai jamais été. Mais enfin, puisque vous voulez que j’écrive mon histoire, et que c’est une chose que vous demandez à mon amitié, soyez satisfaite, j’aime encore mieux vous ennuyer que de vous refuser.
Au reste, je parlais tout à l’heure de style, je ne sais pas seulement ce que c’est. Comment fait-on pour en avoir un ? Celui que je vois dans les livres, est-ce le bon ? Pourquoi donc est-ce qu’il me déplaît tant le plus souvent ? Celui de mes lettres vous paraît-il passable ? J’écrirai ceci de même.
N’oubliez pas que vous m’avez promis de ne jamais dire qui je suis : je ne veux être connue que de vous.
Il y a quinze ans que je ne savais pas encore si le sang d’où je sortais était noble ou non, si j’étais bâtarde ou légitime. Ce début paraît annoncer un roman : ce n’en est pourtant pas un que je raconte ; je dis la vérité comme je l’ai apprise de ceux qui m’ont élevée.
Un carrosse de voiture qui allait à Bordeaux fut, dans la route, attaqué par des voleurs ; deux hommes qui étaient dedans voulurent faire résistance, et blessèrent d’abord un des voleurs ; mais ils furent tués avec trois autres personnes : il en coûta aussi la vie au cocher et au postillon, et il ne restait plus dans la voiture qu’un chanoine de Sens et moi, qui paraissais n’avoir tout au plus que deux ou trois ans. Le chanoine s’enfuit, pendant que, tombée dans la portière, je faisais des cris épouvantables, à demi étouffée sous le corps d’une femme qui avait été blessée, et qui, malgré cela, voulant se sauver, était retombée dans la portière où elle mourut sur moi, et m’écrasait.
Avant que de donner cette histoire au public, il faut lui apprendre comment je l’ai trouvée.
Il y a six mois que j’achetai une maison à quelques lieues de Rennes, qui, depuis trente ans, a passé successivement entre les mains de cinq ou six personnes. J’ai voulu faire changer quelque chose à la disposition du premier appartement, et, dans une armoire pratiquée dans l’enfoncement d’un mur, on y a trouvé un manuscrit en plusieurs cahiers contenant l’histoire qu’on va lire, et le tout d’une écriture de femme. On me l’apporta ; je le lus avec deux de mes amis qui étaient chez moi, et qui, depuis ce jour-là, n’ont cessé de me dire qu’il fallait le faire imprimer : je le veux bien, d’autant plus que cette histoire n’intéresse personne. Nous voyons, par la date que nous avons trouvée à la fin du manuscrit, qu’il y a quarante ans qu’il est écrit ; nous avons changé le nom de deux personnes dont il est parlé, et qui sont mortes. Ce qui est dit d’elles est pourtant très indifférent ; mais n’importe : il est mieux de supprimer leurs noms.
Voilà tout ce que j’avais à dire : ce petit préambule m’a paru nécessaire ; et je l’ai fait du mieux que j’ai pu ; car je ne suis point auteur, et jamais on n’imprimera de moi que cette vingtaine de lignes-ci.
Passons maintenant à l’histoire. C’est une femme qui raconte sa vie ; nous ne savons qui elle était. C’est la Vie de Marianne ; c’est ainsi qu’elle se nomme elle-même au commencement de son histoire ; elle prend ensuite le titre de comtesse ; elle parle à une de ses amies dont le nom est en blanc, et puis c’est tout.
Quand je vous ai fait le récit de quelques accidents de ma vie, je ne m’attendais pas, ma chère amie, que vous me prieriez de vous la donner tout entière et d’en faire un livre à imprimer. Il est vrai que l’histoire est particulière, mais je la gâterai si je l’écris ; car où voulez-vous que je prenne un style ?
Il est vrai que dans le monde on m’a trouvé de l’esprit ; mais, ma chère, je crois que cet esprit-là n’est bon qu’à être dit, et ne vaut rien à être lu.
Nous autres jolies femmes (car j’ai été de ce nombre), personne n’a plus d’esprit que nous quand nous en avons un peu ; les hommes ne savent plus alors la valeur de ce que nous disons : en nous écoutant parler, ils nous regardent, et ce que nous disons profite de ce qu’ils voient.
J’ai vu une jolie femme dont la conversation passait pour un enchantement. Personne au monde ne s’exprimait comme elle ; c’était la vivacité, c’était la finesse même qui parlait : les connaisseurs n’y pouvaient tenir de plaisir. La petite vérole lui vint, elle en fut extrêmement marquée : quand la pauvre femme reparut, ce n’était plus qu’une babillarde incommode. Voyez combien auparavant elle avait emprunté d’esprit de son visage ! Il se pourrait bien faire que le mien m’en eût prêté aussi dans le temps qu’on m’en trouvait beaucoup. Je me souviens de mes yeux de ce temps-là, et je crois qu’ils avaient plus d’esprit que moi.
Combien de fois me suis-je surprise à dire des choses qui auraient eu bien de la peine à passer toutes seules : sans le jeu d’une physionomie friponne qui les accompagnait, on ne m’aurait pas applaudie comme on faisait ; et si une petite vérole était venue réduire cela à ce que cela valait, franchement, je pense que j’y aurais perdu beaucoup.
Il n’y a pas plus d’un mois, par exemple, que vous me parliez encore d’un certain jour (et il y a douze ans que ce jour est passé), où dans un repas on se récria tant sur ma vivacité ; eh bien en conscience, je n’étais qu’une étourdie. Croiriez-vous que je l’ai été souvent exprès, pour voir jusqu’où va la duperie des hommes avec nous ? Tout me réussissait, et je vous assure que, dans la bouche d’une laide, mes folies auraient paru dignes des Petites-Maisons, et peut-être que j’avais besoin d’être aimable dans tout ce que je disais de mieux : car à cette heure que mes agréments sont passés, je vois qu’on me trouve un esprit assez ordinaire, et cependant je suis plus contente de moi que je ne l’ai jamais été. Mais enfin, puisque vous voulez que j’écrive mon histoire, et que c’est une chose que vous demandez à mon amitié, soyez satisfaite, j’aime encore mieux vous ennuyer que de vous refuser.
Au reste, je parlais tout à l’heure de style, je ne sais pas seulement ce que c’est. Comment fait-on pour en avoir un ? Celui que je vois dans les livres, est-ce le bon ? Pourquoi donc est-ce qu’il me déplaît tant le plus souvent ? Celui de mes lettres vous paraît-il passable ? J’écrirai ceci de même.
N’oubliez pas que vous m’avez promis de ne jamais dire qui je suis : je ne veux être connue que de vous.
Il y a quinze ans que je ne savais pas encore si le sang d’où je sortais était noble ou non, si j’étais bâtarde ou légitime. Ce début paraît annoncer un roman : ce n’en est pourtant pas un que je raconte ; je dis la vérité comme je l’ai apprise de ceux qui m’ont élevée.
Un carrosse de voiture qui allait à Bordeaux fut, dans la route, attaqué par des voleurs ; deux hommes qui étaient dedans voulurent faire résistance, et blessèrent d’abord un des voleurs ; mais ils furent tués avec trois autres personnes : il en coûta aussi la vie au cocher et au postillon, et il ne restait plus dans la voiture qu’un chanoine de Sens et moi, qui paraissais n’avoir tout au plus que deux ou trois ans. Le chanoine s’enfuit, pendant que, tombée dans la portière, je faisais des cris épouvantables, à demi étouffée sous le corps d’une femme qui avait été blessée, et qui, malgré cela, voulant se sauver, était retombée dans la portière où elle mourut sur moi, et m’écrasait.