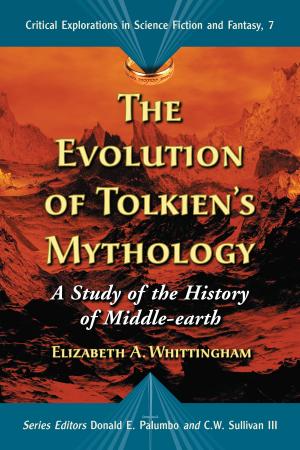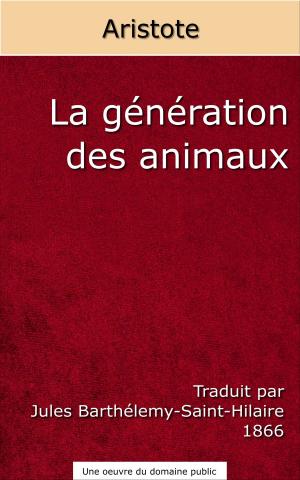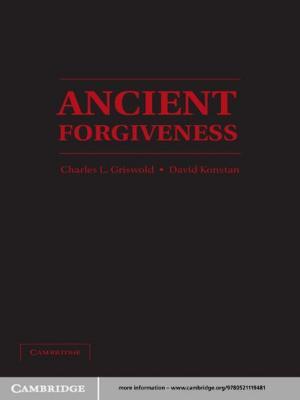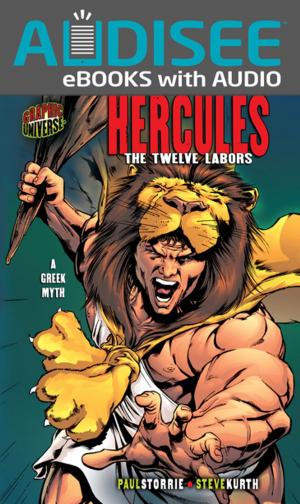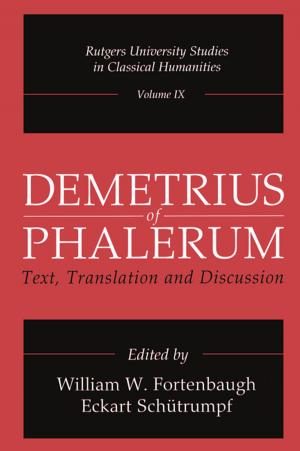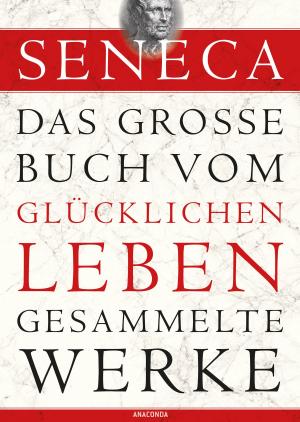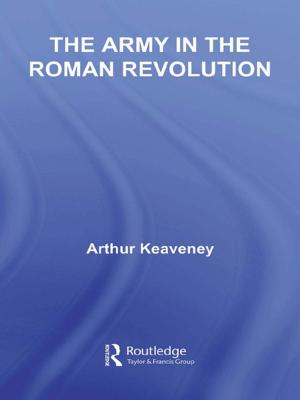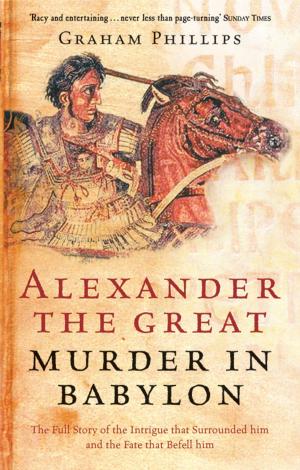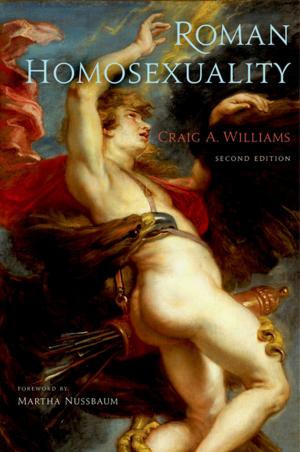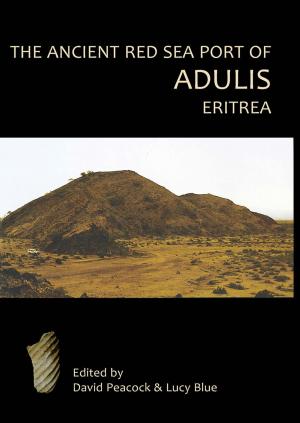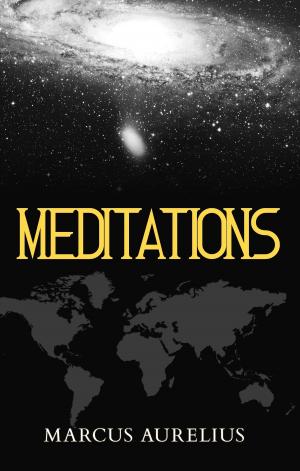Le néokantisme en France. La morale critique
Nonfiction, Religion & Spirituality, Philosophy, Ancient| Author: | Alfred Fouillée | ISBN: | 1230001506297 |
| Publisher: | Alfred Fouillée | Publication: | January 14, 2017 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Alfred Fouillée |
| ISBN: | 1230001506297 |
| Publisher: | Alfred Fouillée |
| Publication: | January 14, 2017 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
EXTRAIT:
I. — LA MORALE CRITICISTE
Depuis plusieurs années s’est produit en France un mouvement néo-kantien qui n’est pas sans importance. Les disciples de Kant espèrent faire tout ensemble la part de la science et la part de la foi en fondant la métaphysique et la religion sur la morale. Primauté de la raison pratique, souveraineté de la morale sur la métaphysique et peut-être même sur la science, telle est la thèse que, de nos jours, plus d’un philosophe soutient en France comme en Allemagne. Cette thèse suppose le kantisme préalablement en possession d’une morale certaine, dont les principes absolus et indiscutables peuvent s’opposer aux hypothèses aventureuses des métaphysiciens. C’est la légitimité de cette prétention, c’est la valeur et la certitude de la morale néo-kantienne que nous nous proposons d’examiner, comme nous avons examiné ailleurs la morale et la morale positiviste[1]. En morale comme en métaphysique le kantisme ne serait-il point une simple transition, une de ces positions intermédiaires que la pensée traverse au moment d’entrer dans une ère nouvelle, mais où elle ne peut s’arrêter ? — L’histoire même de la philosophie kantienne semblerait l’indiquer : Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer et ses disciples actuels s’en sont-ils tenus à la position de Kant ? Ils sont revenus à la métaphysique et ont construit avec de vieux matériaux un nouveau panthéisme. En Angleterre, la philosophie s’en est-elle tenue au kantisme plus ou moins confus d’ailleurs de Hamilton ? Elle est allée en avant vers le naturalisme. En France, les philosophes ont-ils généralement accepté la suspension de jugement des kantiens ou celle du positivisme, qui est par certains côtés un kantisme sans critique préalable de l’intelligence ? Les uns sont retournés au spiritualisme de Leibniz et de Descartes ; les autres (parmi lesquels les positivistes mêmes, malgré leurs protestations de neutralité) ont contribué à l’établissement du naturalisme et ont soutenu même un naturalisme exclusivement matérialiste. Parmi les kantiens eux-mêmes, il en est, comme M. Renouvier, qui sont revenus au phénoménisme de Hume. Ainsi, à ne consulter que les faits, on voit se vérifier l’adage cher aux Allemands : la roue de l’histoire ne saurait demeurer immobile ; si elle tourne parfois sur place, elle finit toujours par avancer.
[1] Voire la Revue des Deux-Mondes, 15 juillet, 1er septembre 1880
EXTRAIT:
I. — LA MORALE CRITICISTE
Depuis plusieurs années s’est produit en France un mouvement néo-kantien qui n’est pas sans importance. Les disciples de Kant espèrent faire tout ensemble la part de la science et la part de la foi en fondant la métaphysique et la religion sur la morale. Primauté de la raison pratique, souveraineté de la morale sur la métaphysique et peut-être même sur la science, telle est la thèse que, de nos jours, plus d’un philosophe soutient en France comme en Allemagne. Cette thèse suppose le kantisme préalablement en possession d’une morale certaine, dont les principes absolus et indiscutables peuvent s’opposer aux hypothèses aventureuses des métaphysiciens. C’est la légitimité de cette prétention, c’est la valeur et la certitude de la morale néo-kantienne que nous nous proposons d’examiner, comme nous avons examiné ailleurs la morale et la morale positiviste[1]. En morale comme en métaphysique le kantisme ne serait-il point une simple transition, une de ces positions intermédiaires que la pensée traverse au moment d’entrer dans une ère nouvelle, mais où elle ne peut s’arrêter ? — L’histoire même de la philosophie kantienne semblerait l’indiquer : Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer et ses disciples actuels s’en sont-ils tenus à la position de Kant ? Ils sont revenus à la métaphysique et ont construit avec de vieux matériaux un nouveau panthéisme. En Angleterre, la philosophie s’en est-elle tenue au kantisme plus ou moins confus d’ailleurs de Hamilton ? Elle est allée en avant vers le naturalisme. En France, les philosophes ont-ils généralement accepté la suspension de jugement des kantiens ou celle du positivisme, qui est par certains côtés un kantisme sans critique préalable de l’intelligence ? Les uns sont retournés au spiritualisme de Leibniz et de Descartes ; les autres (parmi lesquels les positivistes mêmes, malgré leurs protestations de neutralité) ont contribué à l’établissement du naturalisme et ont soutenu même un naturalisme exclusivement matérialiste. Parmi les kantiens eux-mêmes, il en est, comme M. Renouvier, qui sont revenus au phénoménisme de Hume. Ainsi, à ne consulter que les faits, on voit se vérifier l’adage cher aux Allemands : la roue de l’histoire ne saurait demeurer immobile ; si elle tourne parfois sur place, elle finit toujours par avancer.
[1] Voire la Revue des Deux-Mondes, 15 juillet, 1er septembre 1880