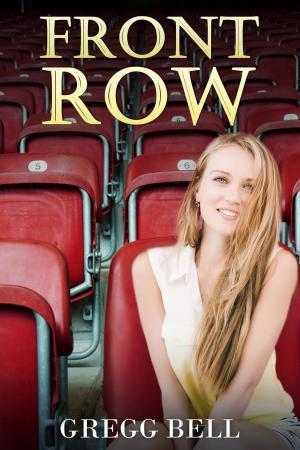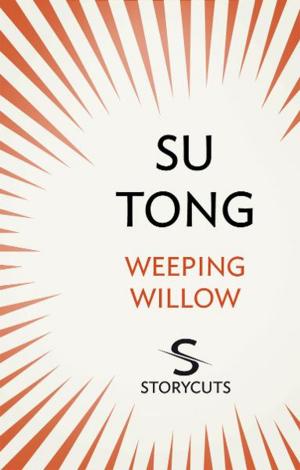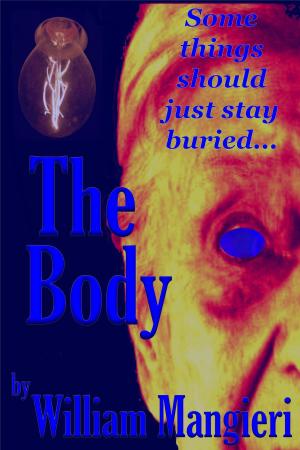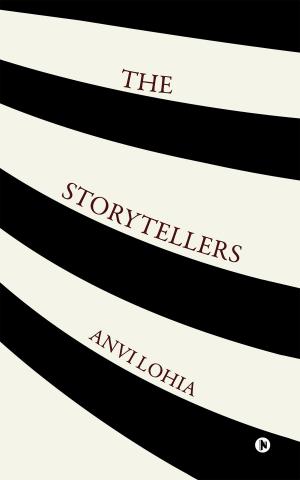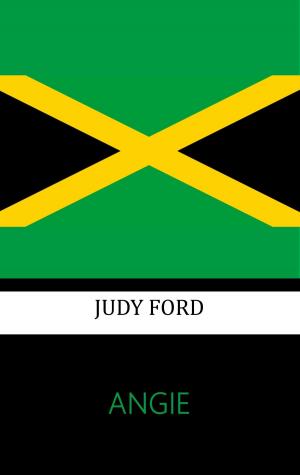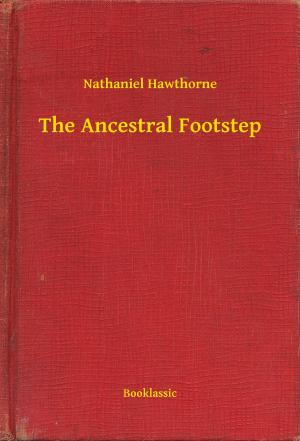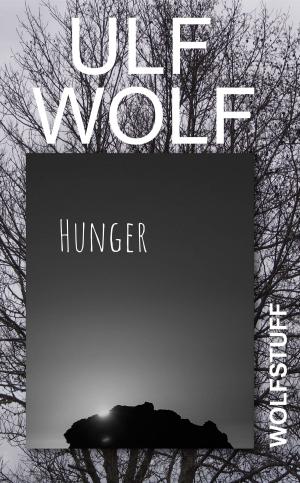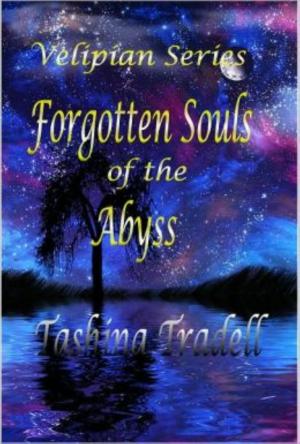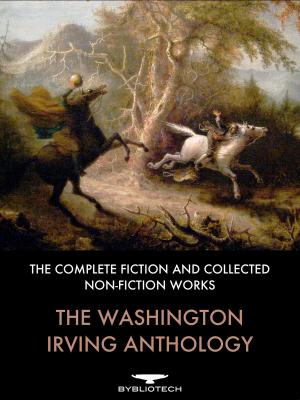Les Mères de famille
Suivi de Mademoiselle Merquem - Le poëme de Myrza-Hamlet - Quelques réflexions sur J.-J. Rousseau - Procope le grand - Metella - MATTEA - Garibaldi - La Fée qui court et 11 autres Nouvelles ( Edition intégrale ) annoté
Fiction & Literature, Anthologies, Romance, Science Fiction & Fantasy, Short Stories| Author: | George Sand | ISBN: | 1230003370308 |
| Publisher: | J. Hetzel , Paris, 1853 | Publication: | August 17, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | George Sand |
| ISBN: | 1230003370308 |
| Publisher: | J. Hetzel , Paris, 1853 |
| Publication: | August 17, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Vingt nouvelles de George Sand
« Quelle est donc cette grosse femme qui danse ? demandai-je au Parisien qui me pilotait pour la première fois à travers le bal.
— C’est ma tante, me dit-il, une personne très-gaie, très-jeune et, comme vous le voyez à ses diamants, très-riche. »
Très-riche, très-gaie, cela se peut, pensai-je ; mais très-jeune, cela ne se peut pas. Je la regardais tout ébahi, et, ne pouvant découvrir nulle trace de sa jeunesse, je me hasardai à demander le compte de ses années.
« Voilà une sotte question, répondit Arthur, riant de ma balourdise. J’hérite de ma tante, mon cher, je ne dis point son âge. » Et voyant que je ne comprenais pas, il ajouta : « Je n’ai pas envie d’être déshérité. Mais venez, que je vous présente à ma mère. Elle a été très-liée autrefois avec la vôtre, et elle aura du plaisir à vous voir. »
Mademoiselle Merquem - Michel Lévy frères, Paris, 1873
De George Sand, tout le monde connaît François le Champi et la Mare au diable, romans champêtres évoquant l’univers rustique du Berry.
L’œuvre est pourtant diversifiée et considérable, riche de trésors méconnus, comme Mademoiselle Merquem, publié en 1868, qui, entre conte et roman utopique, offre une vision idéalisée de la société et de l’amour.
Un village de pêcheurs sur la côte normande sert de décor à l’étonnante éducation sentimentale qui s’accomplit là. L’inventivité narrative, le charme romanesque et la finesse des vues exprimées réussissent à faire la preuve du talent toujours renouvelé de la “dame de Nohant”.
Le poëme de Myrza - Hamlet - 1835
Durant les quatre ou cinq siècles au milieu desquels est jeté le grand événement de la vie du Christ, l’intelligence humaine fut en proie aux douleurs et aux déchirements de l’enfantement. Les hommes supérieurs de la civilisation, sentant la nécessité d’un renouvellement total dans les idées et dans la conduite des nations, furent éclairés de ces lueurs divines dont Jésus fut le centre et le foyer. Les sectes se formèrent autour de sa courte et sublime apparition, comme des rayons plus ou moins chauds de son astre. Il y eut des caraïtes, des saducéens et des esséniens, des manichéens et des gnostiques, des épicuriens, des stoïciens et des cyniques, des philosophes et des prophètes, des devins et des astrologues, des solitaires et des martyrs: les uns partant du spiritualisme de Jésus, comme Origène et Manès; les autres essayant d’y aller, sur les pas de Platon et de Pythagore; tous escortant l’Évangile, soit devant, soit derrière, et travaillant par leur dévouement ou leur résistance à consolider son triomphe.
Relation d’un voyage chez les sauvages de Paris - J. Hetzel, Paris, 1853
C’est la George Sand (1804-1876) humaniste et passionnée qui rapporte, dans Relation d’un voyage chez les sauvages de Paris, sa rencontre, à quelques encablures de chez elle, avec des Peaux-Rouges.Dans ces pages, se déploie l’Amérique sauvage,originelle qui, brisée, cherche à survivre parmi les Blancs en préservant sa culture. Étude de mœurs et critique sociale, cette lettre à un ami, parue en 1846 est aussi le récit d’une fascination pour un peuple, dit primitif, confronté à la société occidentale.
Quelques réflexions sur J.-J. Rousseau - J. Hetzel , Paris, 1853
« … . . J’allai de là visiter les Charmettes. Pour arriver à l’humble enclos, il faut suivre un petit vallon que traverse un petit ruisseau, et dont les pentes sont tapissées de prairies semées de jeunes taillis et bordées de vieux arbres. C’est un site frais, solitaire et tranquille, qui rappelle un peu nos traînes de la Renardière. Après un quart-d’heure de marche, on est en face de la maisonnette. — Un toit en croupe dont l’ardoise ternie imite à s’y méprendre des rebardeaux usés par le temps, des contrevents verts, une petite terrasse fermée par une barrière rustique, et, dans son prolongement, le jardinet où Jean-Jacques aimait à cultiver des fleurs. — Le jardin a toujours ma première visite. J’y cherchai le cabinet de houblon ; mais il a disparu. Je cueillis pour vous quelques rameaux d’un vieux buis, que je suppose être un des plus anciens hôtes de cet enclos. L’on assure que l’intérieur des appartements n’a point été changé : c’est un carreau de pièces inégales, des murs peints à la détrempe, avec des oiseaux et des fleurs imaginaires sur les impostes. À part une petite épinette, où Rousseau s’exerça sans doute bien souvent à déchiffrer la musique de Rameau, le surplus du mobilier rappelle beaucoup celui de Philémon ; mais propre et rangé comme si le maître n’était parti que d’hier. Tout ici respire la simplicité, l’innocence et le bonheur. Que de douces et tristes pensées évoque la vue de ces chaumières ! leur histoire est celle de nos plus beaux jours ! jours trop tôt écoulés, et dont il n’est pas sage de rêver le retour !
La Marquise - Michel Lévy frères, éditeurs — Librairie nouvelle, 1856
En sortant du couvent à seize ans, la Marquise fut contrainte d’épouser un aristocrate de cinquante ans, froid et méprisant, qui la dégoûta du contact des hommes. Elle fut bientôt veuve et abandonnée dans une société aristocratique dissolue du 18e siècle, qui voulut la corrompre. Elle resta pourtant chaste, non par goût, mais par dégoût des hommes. Pour échapper aux pressions de son entourage, elle se lia au Vicomte de Larrieux, qui, contrairement aux autres, n’était pas méchant. Il était bête cependant, et uniquement préoccupé de plaisirs matériels. Elle lui resta fidèle durant soixante ans. Seul l’amour tout spirituel et élevé qu’elle voua au comédien Lélio illumina sa vie pendant cinq ans. Mais elle aimait plus les nobles sentiments des personnages interprétés par le comédien, que l’homme lui-même. Lélio, hors de scène, s’avérait être un individu sans attrait.
Procope le grand - Paris Hetzel, 1853
Cette nouvlle raconte l’histoire de Procope le Grand – surnommé également le Tondu (tch. Prokop Holý ou Prokop Veliký) (né vers 1380 – mort le 30 mai 1434 à la bataille de Lipany), prédicateur hussite radical, devient, après la mort de Jan Žižka, hetman des armées hussites.
La profession; prêtre • guerrier
Metella - J. Hetzel, 1852
Lady Mowbrav habitait un palais magnifique ; le comte mit quelque affectation à y entrer comme chez lui, et à parler aux domestiques comme s’ils eussent été les siens. Olivier se tenait sur ses gardes et observait les moindres mouvements de son guide. La pièce où ils attendirent était décorée avec un art et une richesse dont le comte semblait orgueilleux, bien qu’il n’y eût coopéré ni par son argent ni par son goût.
Cependant il fit les honneurs des tableaux de lady Mowbrav comme s’il avait été son maître de peinture, et semblait jouir de l’émotion insurmontable avec laquelle Olivier attendait l’apparition de lady Mowbrav.
MATTEA - Revue des Deux Mondes, 1835
Mattea, adolescente de quatorze ans d’une grande beauté, est la fille de Zacomo Spada, un marchand de soieries vénitien. Beaucoup d’hommes tentent de lui faire la cour, mais elle sait les tenir à distance avec des regards froids. Les deux seuls hommes, qu’elle n’a pas envie de repousser de prime abord, sont le Turc Abul, qui est en affaires avec son père, et son interprète Grec, Timothée. Le Turc est un homme droit et honnête jusqu’à la candeur. Timothée est souvent contraint de le défendre contre la rouerie de certains marchands dont Zacomo Spada fait partie. Mattea voudrait s’enfuir de chez elle où sa mère, violente et acariâtre, lui fait vivre un enfer. Pour la provoquer, elle déclare qu’elle est amoureuse du Turc et qu’elle veut partir avec lui. La réaction violente de la mère ne se fait pas attendre. En sang, Mattea s’enfuit de chez elle et cherche refuge auprès d’Abul. Mais c’est Timothée qui l’aide à quitter Venise. Plus tard, Timothée et Mattea se marient dotés par le bon Abul. A la mort de sa mère, Mattea se réconcilie avec son père.
Garibaldi - A. Bourdilliat, 1860
Un an ne s’est pas écoulé depuis le jour anniversaire de la naissance de Garibaldi. — Ce même jour, nous écrivions sur ce héros quelques pages que nous réimprimons aujourd’hui et que nous ferons suivre des réflexions suggérées par la nouvelle situation de l’Italie.
À travers les sentiers emportés par les pluies d’orage et semés des formidables débris écroulés la veille, je marchais, il y a quelques jours, dans un pays sublime. Ruines imposantes des antiques volcans, les montagnes, couvertes d’immenses pâturages, avaient revêtu leurs robes vertes, diaprées de renoncules et de narcisses. Un beau soleil faisait étinceler encore des neiges obstinées, tandis qu’à deux pas de l’éternel hiver, les vaches tachetées broutaient en paix les fleurs nouvelles, et qu’un grand aigle décrivait, avec son ombre portée, des cercles majestueux et lents sur la vaste arène des prairies.
À l’abri des plus hautes cimes, sur ces plateaux élevés, derniers sanctuaires de la vie pastorale, quelques êtres humains, clair-semés dans les chalets, semblaient devoir ignorer que le monde était en feu, et qu’au delà de ces incommensurables horizons où l’œil devine les Alpes, le canon grondait plus haut que le tonnerre, tandis que les vautours planaient sur des champs de bataille.
Et pourtant, ces hôtes de l’éternelle solitude, ces gardeurs de troupeaux, ces enfants de l’herbe et des nuages, qui, durant les jours de l’été, deviennent étrangers même à leur famille, savaient la guerre et connaissaient les noms des braves.
Monsieur Rousset - J. Hetzel, 1853.
Enfin, après s’être longtemps fait prier, il parla ainsi :C’était en 1730, j’avais alors une vingtaine d’années, j’étais assez joli garçon, quoiqu’il n’y paraisse guère aujourd’hui. Je n’avais pas ce crâne dégarni, ce gros nez, ces petits yeux éraillés, ces joues flétries ; j’avais le teint frais, l’?il vif, le nez vierge de tabac, la taille élégante dans sa petitesse, le jarret tendu, la jambe admirable comme cela peut se voir encore. En somme, j’étais un joli petit cavalier, point gauche, nullement timide, et déjà stylé à prendre toutes les manières, soit bonnes, soit mauvaises, des gens avec qui je me trouvais ; faisant des madrigaux avec les belles dames, jurant avec les soudards, philosophant avec les beaux esprits, raisonnant avec les ecclésiastiques, et déraisonnant avec les marquis. Enfin je plaisais et je réussissais partout, et ma profession de comédien homme de lettres était un passe-port qui me faisait également bien accueillir dans la bonne comme dans la mauvaise compagnie. Je me rendais de Lyon à Dijon par le coche, pour rejoindre la troupe de campagne dont je faisais partie? C’était vers le milieu de l’automne, le temps était brumeux et déjà assez frais. Je me trouvai faire une dizaine de lieues avec un certain baron de Guernay qu’une affaire avait appelé dans les environs, et qui retournait coucher à son château situé dans une petite vallée de Bourgogne, à cent pas de la grand’route. Il était grand causeur, grand questionneur, grand amateur de vers et de romans. Je le charmai par ma conversation, et il ne sut pas plus tôt que j’étais auteur et acteur, qu’il ne voulut plus se séparer de moi. C’était un de ces dilettanti qui ont toujours en poche quelque petite drôlerie dramatique et qui espèrent vous la faire trouver excellente et vous en faire cadeau, pour avoir le plaisir de la voir représentée au prochain chef-lieu de bailliage sans bourse délier. Je ne m’y laissai point prendre, mais j’acceptai l’offre qu’il me fit de passer la nuit dans son manoir. Le coche s’arrêtait fort peu plus loin, et la tenue de mon baron m’annonçait un meilleur gîte et un meilleur souper que l’hôtellerie où j’aurais été forcé de passer douze ou quinze heures en attendant de pouvoir repartir…
La Guerre - A. Bourdilliat et Cie, Paris, 1859
Ce matin, j’étais un poëte, un rêveur. Hier, je n’étais rien du tout, j’étais malade, abattu par la fièvre du beau et perfide mois de mai. Mon lourd sommeil s’était rempli d’un rêve monotone, obstiné. Je croyais marcher dans une foule armée, sous un ciel noir, par une nuit de raffales et de nuées. Des hommes noirs se pressaient à mes côtés, j’étais un homme noir moi-même. Nous avancions, parlant tous ensemble sans tumulte, mais avec feu, et nous nous disions tous, à chaque instant, les uns aux autres : « Avançons, serrons-nous, que personne ne s’arrête, que personne ne se retourne si ce n’est pour appeler, presser et encourager ceux que le vent et la nuit retardent. »
Et cette route sans fin était pleine, pleine à n’y pas mettre un piéton de plus. Pourtant des chariots, des canons, des chevaux, sillonnaient à chaque instant la vague humaine, et on les aidait à la traverser, et tout avançait comme par miracle, la multitude augmentant toujours et touchant, comme un fleuve sombre, aux deux bouts du sombre horizon.
J’étais fatigué, mais la pensée de me reposer ne pouvait pas me venir. Tout marchait, il fallait marcher, et dans cette foule sérieuse à l’œuvre, il y avait de la gaieté française, des rires et des mots. L’un disait : « Ce n’est pas nous qui peinons le plus, c’est la terre forcée de porter tant de monde, et pourtant elle ne dit rien. » — Un autre s’adressant à moi : « Tu vois bien que tant de jambes en mouvement ont la force de porter une armée. » Et, dans le rêve, je trouvais un sens clair et juste à ces vagues plaisanteries. Je sentais que la force active s’impose fièrement à la force inerte, et que beaucoup de jambes portant beaucoup de cœurs, une légion marchait en effet plus vite et mieux qu’un seul homme.
Chaillot - Paris, ou Le livre des cent-et-un,1834
Entre les Champs-Élysées et le bois de Boulogne, sur le coteau qui domine la rive droite de la Seine, s’élève, au milieu des arbres et des fleurs, un village, tapi dans ses jardins comme dans un nid de verdure. Cité pour la première fois dans un acte de la fin du xie siècle, il porta successivement les noms de Caleio, Callevio, Challoel, et ce ne fut qu’au xive siècle que l’on commença à écrire Chailleau, Chailliau, puis enfin Chaillot. Réuni à Paris par un édit de juillet 1659, Chaillot est devenu un des faubourgs de la capitale, sous le nom de faubourg de la Conférence. Mais cet excès d’honneur ne l’a point enivré. Le hameau est resté campagnard à la ville : il a gardé son nom rustique, son aspect villageois ; et bien que le commerce et l’industrie l’envahissent de toutes parts et menacent d’en chasser bientôt tout silence et toute poésie, c’est encore un asile où les âmes fatiguées peuvent se faire, aux portes de Paris, une vie calme et pleine de loisirs.
Chaillot fut de bonne heure érigé en paroisse : en 1097, cette cure appartenait au prieuré de Saint-Martin-des-Champs. En 1450, à l’extinction des seigneurs particuliers de cette terre, elle passa sous la domination des seigneurs de Marly-le-Château ; mais le roi en conserva la haute-justice, dont il se démit en faveur de son chambellan, Philippe de Comines. La haute-justice de Chaillot revint à la couronne ; mais en 1633 elle appartenait encore au maréchal de Bassompierre, et plus tard nous la voyons passer aux religieuses de la Visitation.
La Marraine chapitre De l’amour - La Revue de Paris, 15 mai 1895
Ma marraine parlait à M. Lesec. Elle disait :
— L’amour ? L’amour de l’homme pour la femme, je ne sais ce que c’est et j’ai toujours pensé que c’était bien peu de chose. Mais l’amour de la femme ! cet amour qui, né dans le silence, s’est glissé mystérieusement dans son sein, ignoré de celui qui l’inspira, ignoré de celle même qui l’éprouve, qui bientôt, grandissant, comme un enfant capricieux et mutin, fait naître les soucis et les larmes, qui, jaloux, injuste, exigeant, mais encore caché, commence à se révéler seulement au cœur qu’il ronge et qu’il asservit, qui chaque jour croît dans le secret des plus intimes pensées, s’insinue, pénètre comme un poison, breuvage funeste, mais enivrant, qu’on savoure sans prudence et qui bientôt après dévore les entrailles et, comme un feu liquide, court de veine en veine avec le sang et la vie !… ô femmes, s’il en est parmi vous quelqu’une qui ne l’ait jamais ressenti, cet amour brûlant, qu’elle n’ose pas s’en vanter ou qu’elle se vante de n’être pas femme ! Stérile de cœur, elle a passé comme une fleur sans éclat, sans parfum et sans fruit. Vide de souvenirs, elle n’a connu de la vie ni les cuisantes douleurs, ni les joies délirantes. Insensible et nulle, elle n’a eu de son sexe ni les misérables faiblesses, ni les héroïques passions !
» La femme qui aime est de tous les êtres le plus courageux, le plus magnanime, le plus constant, le plus dévoué. Demandez-lui tout ce qui est grand, tout ce qui est énergique, tout ce qui semble au-dessus des forces humaines et des penchants de la nature ; vous l’obtiendrez, car sa passion fait d’elle une fanatique prête au martyre, une sainte digne du ciel ; mais ne lui demandez pas le sang de l’innocent, car elle vous le donnerait, ne lui prescrivez pas le vice, le déshonneur, la trahison, l’adultère car elle vous obéirait, et, d’un ange de Dieu, vous feriez un démon du mal.
George Sand aux riches Suivi d’une note signée « Les Icariens » - Imp. Laroche-Jacob, Sedan, 1848
« La grande crainte, ou le grand prétexte de l’aristocratie à l’heure qu’il est, c’est l’idée Communiste. S’il y avait moyen de rire dans un temps si sérieux, cette frayeur aurait de quoi nous divertir. Sous ce mot de Communisme, on sous-entend le peuple, ses besoins, ses aspirations. Ne confondons point : le Peuple, c’est le Peuple ; le Communisme, c’est l’avenir calomnié et incompris du Peuple.
» La ruse est ici fort inutile ; c’est le peuple qui vous gêne et vous inquiète ; c’est la république dont vous craignez le développement. C’est le droit de tous que vous ne supportez pas sans malaise et sans dépit. Un peu de réflexion vous remettrait pourtant l’esprit. La conquête que le peuple a faite de son droit vous arrache-t-elle donc des mains le droit que vous exerciez ? Vous croyez-vous sous le régime de la Terreur ? Avons-nous demandé la tête du roi, de la reine, des princes et princesses ? Avons-nous rasé les châteaux, persécuté les prêtres ? Demandons-nous la loi agraire ?
» D’ailleurs, outre que les fatales nécessités du passé n’existent plus et qu’il serait impolitique de faire des victimes, vous nous outragez, vous nous calomniez ; vous vous rabaissez vous-mêmes, si vous niez que, depuis plus d’un demi-siècle, nous ne soyons pas devenus plus humains, plus sages, plus éclairés, plus religieux. Prenez garde, la peur que vous avez nous prouve peu de confiance en vous-mêmes, et si vous méconnaissez le progrès que nous avons pu faire, vous révélez que vous n’en avez fait aucun.
Critique de La Case de l’oncle Tom - 1852
Ce livre est dans toutes les mains, dans tous les journaux. Il aura, il a déjà des éditions dans tous les formats. On le dévore, on le couvre de larmes. Il n’est déjà plus permis aux personnes qui savent lire de ne pas l’avoir lu, et on regrette qu’il y ait tant de gens condamnés à ne le lire jamais : ilotes par la misère, esclaves par l’ignorance, pour lesquels les lois politiques ont été impuissantes jusqu’à ce jour à résoudre le double problème du pain de l’âme et du pain du corps.
La Fauvette du docteur - J. Hetzel, Paris, 1852
Nous avions pour hôte à la campagne, il y a quelques années, un vieux docteur que nous aimions, bien qu’il fût insupportable, parce qu’il avait du bon malgré ses manies. Entre autres maussades habitudes, il fuyait la société des femmes. On eût dit qu’il les haïssait, et pourtant la cause de leur émancipation avait en lui un défenseur opiniâtre. Il semblait qu’il se réservât pour le temps où elles seraient dignes d’être admises à l’égalité sociale, car il ne voulut jamais se marier, et lorsque, pour le taquiner, on le lui conseillait, il répondait avec un sérieux admirable : « Plus tard, plus tard ; il n’est pas encore temps pour moi. » Or, il avait quatre-vingt-deux ans. Huit jours avant sa mort, il nous parut tout gai, tout rajeuni, et comme nous en faisions la remarque, il nous déclara, d’un air enjoué, qu’il avait enfin trouvé la compagne de sa vie, et qu’il se sentait véritablement épris, d’autant plus qu’il se croyait parfaitement aimé. Comme rien dans sa vie de cénobite ne nous parut changé, nous prîmes cet excès de fatuité pour une des rares facéties qui déridaient, une ou deux fois par an, son front chagrin. Un matin, il ne vint pas déjeuner, nous allâmes le chercher, et nous le trouvâmes penché et comme assoupi sur ses livres. Un petit oiseau voltigeait dans sa chambre, dont la fenêtre ouverte laissait tomber sur son vieux crâne les rayons joyeux du soleil de juin. Il était mort.
Les On-dit du Rappel - 14 mai 1876
Sous ce titre : la Science du mécanisme vocal et l’art du chant, Mme Andréa Lacombe publie un livre que nous ne saurions mieux recommander aux amis de la musique qu’en citant les deux lettres suivantes qu’il a values à son auteur.
La Fée qui court - Figaro : journal non politique, 4 juillet 1877 (Un charmant petit conte de George Sand )
Je rencontrai l’autre jour une bonne fée qui courait comme une folle, malgré son grand âge.
À propos du banquet shakespearien - Le Temps - 24 avril 1864
La lettre suivante, de George Sand, était destinée à être lue aujourd’hui, au banquet de Shakespeare
Vingt nouvelles de George Sand
« Quelle est donc cette grosse femme qui danse ? demandai-je au Parisien qui me pilotait pour la première fois à travers le bal.
— C’est ma tante, me dit-il, une personne très-gaie, très-jeune et, comme vous le voyez à ses diamants, très-riche. »
Très-riche, très-gaie, cela se peut, pensai-je ; mais très-jeune, cela ne se peut pas. Je la regardais tout ébahi, et, ne pouvant découvrir nulle trace de sa jeunesse, je me hasardai à demander le compte de ses années.
« Voilà une sotte question, répondit Arthur, riant de ma balourdise. J’hérite de ma tante, mon cher, je ne dis point son âge. » Et voyant que je ne comprenais pas, il ajouta : « Je n’ai pas envie d’être déshérité. Mais venez, que je vous présente à ma mère. Elle a été très-liée autrefois avec la vôtre, et elle aura du plaisir à vous voir. »
Mademoiselle Merquem - Michel Lévy frères, Paris, 1873
De George Sand, tout le monde connaît François le Champi et la Mare au diable, romans champêtres évoquant l’univers rustique du Berry.
L’œuvre est pourtant diversifiée et considérable, riche de trésors méconnus, comme Mademoiselle Merquem, publié en 1868, qui, entre conte et roman utopique, offre une vision idéalisée de la société et de l’amour.
Un village de pêcheurs sur la côte normande sert de décor à l’étonnante éducation sentimentale qui s’accomplit là. L’inventivité narrative, le charme romanesque et la finesse des vues exprimées réussissent à faire la preuve du talent toujours renouvelé de la “dame de Nohant”.
Le poëme de Myrza - Hamlet - 1835
Durant les quatre ou cinq siècles au milieu desquels est jeté le grand événement de la vie du Christ, l’intelligence humaine fut en proie aux douleurs et aux déchirements de l’enfantement. Les hommes supérieurs de la civilisation, sentant la nécessité d’un renouvellement total dans les idées et dans la conduite des nations, furent éclairés de ces lueurs divines dont Jésus fut le centre et le foyer. Les sectes se formèrent autour de sa courte et sublime apparition, comme des rayons plus ou moins chauds de son astre. Il y eut des caraïtes, des saducéens et des esséniens, des manichéens et des gnostiques, des épicuriens, des stoïciens et des cyniques, des philosophes et des prophètes, des devins et des astrologues, des solitaires et des martyrs: les uns partant du spiritualisme de Jésus, comme Origène et Manès; les autres essayant d’y aller, sur les pas de Platon et de Pythagore; tous escortant l’Évangile, soit devant, soit derrière, et travaillant par leur dévouement ou leur résistance à consolider son triomphe.
Relation d’un voyage chez les sauvages de Paris - J. Hetzel, Paris, 1853
C’est la George Sand (1804-1876) humaniste et passionnée qui rapporte, dans Relation d’un voyage chez les sauvages de Paris, sa rencontre, à quelques encablures de chez elle, avec des Peaux-Rouges.Dans ces pages, se déploie l’Amérique sauvage,originelle qui, brisée, cherche à survivre parmi les Blancs en préservant sa culture. Étude de mœurs et critique sociale, cette lettre à un ami, parue en 1846 est aussi le récit d’une fascination pour un peuple, dit primitif, confronté à la société occidentale.
Quelques réflexions sur J.-J. Rousseau - J. Hetzel , Paris, 1853
« … . . J’allai de là visiter les Charmettes. Pour arriver à l’humble enclos, il faut suivre un petit vallon que traverse un petit ruisseau, et dont les pentes sont tapissées de prairies semées de jeunes taillis et bordées de vieux arbres. C’est un site frais, solitaire et tranquille, qui rappelle un peu nos traînes de la Renardière. Après un quart-d’heure de marche, on est en face de la maisonnette. — Un toit en croupe dont l’ardoise ternie imite à s’y méprendre des rebardeaux usés par le temps, des contrevents verts, une petite terrasse fermée par une barrière rustique, et, dans son prolongement, le jardinet où Jean-Jacques aimait à cultiver des fleurs. — Le jardin a toujours ma première visite. J’y cherchai le cabinet de houblon ; mais il a disparu. Je cueillis pour vous quelques rameaux d’un vieux buis, que je suppose être un des plus anciens hôtes de cet enclos. L’on assure que l’intérieur des appartements n’a point été changé : c’est un carreau de pièces inégales, des murs peints à la détrempe, avec des oiseaux et des fleurs imaginaires sur les impostes. À part une petite épinette, où Rousseau s’exerça sans doute bien souvent à déchiffrer la musique de Rameau, le surplus du mobilier rappelle beaucoup celui de Philémon ; mais propre et rangé comme si le maître n’était parti que d’hier. Tout ici respire la simplicité, l’innocence et le bonheur. Que de douces et tristes pensées évoque la vue de ces chaumières ! leur histoire est celle de nos plus beaux jours ! jours trop tôt écoulés, et dont il n’est pas sage de rêver le retour !
La Marquise - Michel Lévy frères, éditeurs — Librairie nouvelle, 1856
En sortant du couvent à seize ans, la Marquise fut contrainte d’épouser un aristocrate de cinquante ans, froid et méprisant, qui la dégoûta du contact des hommes. Elle fut bientôt veuve et abandonnée dans une société aristocratique dissolue du 18e siècle, qui voulut la corrompre. Elle resta pourtant chaste, non par goût, mais par dégoût des hommes. Pour échapper aux pressions de son entourage, elle se lia au Vicomte de Larrieux, qui, contrairement aux autres, n’était pas méchant. Il était bête cependant, et uniquement préoccupé de plaisirs matériels. Elle lui resta fidèle durant soixante ans. Seul l’amour tout spirituel et élevé qu’elle voua au comédien Lélio illumina sa vie pendant cinq ans. Mais elle aimait plus les nobles sentiments des personnages interprétés par le comédien, que l’homme lui-même. Lélio, hors de scène, s’avérait être un individu sans attrait.
Procope le grand - Paris Hetzel, 1853
Cette nouvlle raconte l’histoire de Procope le Grand – surnommé également le Tondu (tch. Prokop Holý ou Prokop Veliký) (né vers 1380 – mort le 30 mai 1434 à la bataille de Lipany), prédicateur hussite radical, devient, après la mort de Jan Žižka, hetman des armées hussites.
La profession; prêtre • guerrier
Metella - J. Hetzel, 1852
Lady Mowbrav habitait un palais magnifique ; le comte mit quelque affectation à y entrer comme chez lui, et à parler aux domestiques comme s’ils eussent été les siens. Olivier se tenait sur ses gardes et observait les moindres mouvements de son guide. La pièce où ils attendirent était décorée avec un art et une richesse dont le comte semblait orgueilleux, bien qu’il n’y eût coopéré ni par son argent ni par son goût.
Cependant il fit les honneurs des tableaux de lady Mowbrav comme s’il avait été son maître de peinture, et semblait jouir de l’émotion insurmontable avec laquelle Olivier attendait l’apparition de lady Mowbrav.
MATTEA - Revue des Deux Mondes, 1835
Mattea, adolescente de quatorze ans d’une grande beauté, est la fille de Zacomo Spada, un marchand de soieries vénitien. Beaucoup d’hommes tentent de lui faire la cour, mais elle sait les tenir à distance avec des regards froids. Les deux seuls hommes, qu’elle n’a pas envie de repousser de prime abord, sont le Turc Abul, qui est en affaires avec son père, et son interprète Grec, Timothée. Le Turc est un homme droit et honnête jusqu’à la candeur. Timothée est souvent contraint de le défendre contre la rouerie de certains marchands dont Zacomo Spada fait partie. Mattea voudrait s’enfuir de chez elle où sa mère, violente et acariâtre, lui fait vivre un enfer. Pour la provoquer, elle déclare qu’elle est amoureuse du Turc et qu’elle veut partir avec lui. La réaction violente de la mère ne se fait pas attendre. En sang, Mattea s’enfuit de chez elle et cherche refuge auprès d’Abul. Mais c’est Timothée qui l’aide à quitter Venise. Plus tard, Timothée et Mattea se marient dotés par le bon Abul. A la mort de sa mère, Mattea se réconcilie avec son père.
Garibaldi - A. Bourdilliat, 1860
Un an ne s’est pas écoulé depuis le jour anniversaire de la naissance de Garibaldi. — Ce même jour, nous écrivions sur ce héros quelques pages que nous réimprimons aujourd’hui et que nous ferons suivre des réflexions suggérées par la nouvelle situation de l’Italie.
À travers les sentiers emportés par les pluies d’orage et semés des formidables débris écroulés la veille, je marchais, il y a quelques jours, dans un pays sublime. Ruines imposantes des antiques volcans, les montagnes, couvertes d’immenses pâturages, avaient revêtu leurs robes vertes, diaprées de renoncules et de narcisses. Un beau soleil faisait étinceler encore des neiges obstinées, tandis qu’à deux pas de l’éternel hiver, les vaches tachetées broutaient en paix les fleurs nouvelles, et qu’un grand aigle décrivait, avec son ombre portée, des cercles majestueux et lents sur la vaste arène des prairies.
À l’abri des plus hautes cimes, sur ces plateaux élevés, derniers sanctuaires de la vie pastorale, quelques êtres humains, clair-semés dans les chalets, semblaient devoir ignorer que le monde était en feu, et qu’au delà de ces incommensurables horizons où l’œil devine les Alpes, le canon grondait plus haut que le tonnerre, tandis que les vautours planaient sur des champs de bataille.
Et pourtant, ces hôtes de l’éternelle solitude, ces gardeurs de troupeaux, ces enfants de l’herbe et des nuages, qui, durant les jours de l’été, deviennent étrangers même à leur famille, savaient la guerre et connaissaient les noms des braves.
Monsieur Rousset - J. Hetzel, 1853.
Enfin, après s’être longtemps fait prier, il parla ainsi :C’était en 1730, j’avais alors une vingtaine d’années, j’étais assez joli garçon, quoiqu’il n’y paraisse guère aujourd’hui. Je n’avais pas ce crâne dégarni, ce gros nez, ces petits yeux éraillés, ces joues flétries ; j’avais le teint frais, l’?il vif, le nez vierge de tabac, la taille élégante dans sa petitesse, le jarret tendu, la jambe admirable comme cela peut se voir encore. En somme, j’étais un joli petit cavalier, point gauche, nullement timide, et déjà stylé à prendre toutes les manières, soit bonnes, soit mauvaises, des gens avec qui je me trouvais ; faisant des madrigaux avec les belles dames, jurant avec les soudards, philosophant avec les beaux esprits, raisonnant avec les ecclésiastiques, et déraisonnant avec les marquis. Enfin je plaisais et je réussissais partout, et ma profession de comédien homme de lettres était un passe-port qui me faisait également bien accueillir dans la bonne comme dans la mauvaise compagnie. Je me rendais de Lyon à Dijon par le coche, pour rejoindre la troupe de campagne dont je faisais partie? C’était vers le milieu de l’automne, le temps était brumeux et déjà assez frais. Je me trouvai faire une dizaine de lieues avec un certain baron de Guernay qu’une affaire avait appelé dans les environs, et qui retournait coucher à son château situé dans une petite vallée de Bourgogne, à cent pas de la grand’route. Il était grand causeur, grand questionneur, grand amateur de vers et de romans. Je le charmai par ma conversation, et il ne sut pas plus tôt que j’étais auteur et acteur, qu’il ne voulut plus se séparer de moi. C’était un de ces dilettanti qui ont toujours en poche quelque petite drôlerie dramatique et qui espèrent vous la faire trouver excellente et vous en faire cadeau, pour avoir le plaisir de la voir représentée au prochain chef-lieu de bailliage sans bourse délier. Je ne m’y laissai point prendre, mais j’acceptai l’offre qu’il me fit de passer la nuit dans son manoir. Le coche s’arrêtait fort peu plus loin, et la tenue de mon baron m’annonçait un meilleur gîte et un meilleur souper que l’hôtellerie où j’aurais été forcé de passer douze ou quinze heures en attendant de pouvoir repartir…
La Guerre - A. Bourdilliat et Cie, Paris, 1859
Ce matin, j’étais un poëte, un rêveur. Hier, je n’étais rien du tout, j’étais malade, abattu par la fièvre du beau et perfide mois de mai. Mon lourd sommeil s’était rempli d’un rêve monotone, obstiné. Je croyais marcher dans une foule armée, sous un ciel noir, par une nuit de raffales et de nuées. Des hommes noirs se pressaient à mes côtés, j’étais un homme noir moi-même. Nous avancions, parlant tous ensemble sans tumulte, mais avec feu, et nous nous disions tous, à chaque instant, les uns aux autres : « Avançons, serrons-nous, que personne ne s’arrête, que personne ne se retourne si ce n’est pour appeler, presser et encourager ceux que le vent et la nuit retardent. »
Et cette route sans fin était pleine, pleine à n’y pas mettre un piéton de plus. Pourtant des chariots, des canons, des chevaux, sillonnaient à chaque instant la vague humaine, et on les aidait à la traverser, et tout avançait comme par miracle, la multitude augmentant toujours et touchant, comme un fleuve sombre, aux deux bouts du sombre horizon.
J’étais fatigué, mais la pensée de me reposer ne pouvait pas me venir. Tout marchait, il fallait marcher, et dans cette foule sérieuse à l’œuvre, il y avait de la gaieté française, des rires et des mots. L’un disait : « Ce n’est pas nous qui peinons le plus, c’est la terre forcée de porter tant de monde, et pourtant elle ne dit rien. » — Un autre s’adressant à moi : « Tu vois bien que tant de jambes en mouvement ont la force de porter une armée. » Et, dans le rêve, je trouvais un sens clair et juste à ces vagues plaisanteries. Je sentais que la force active s’impose fièrement à la force inerte, et que beaucoup de jambes portant beaucoup de cœurs, une légion marchait en effet plus vite et mieux qu’un seul homme.
Chaillot - Paris, ou Le livre des cent-et-un,1834
Entre les Champs-Élysées et le bois de Boulogne, sur le coteau qui domine la rive droite de la Seine, s’élève, au milieu des arbres et des fleurs, un village, tapi dans ses jardins comme dans un nid de verdure. Cité pour la première fois dans un acte de la fin du xie siècle, il porta successivement les noms de Caleio, Callevio, Challoel, et ce ne fut qu’au xive siècle que l’on commença à écrire Chailleau, Chailliau, puis enfin Chaillot. Réuni à Paris par un édit de juillet 1659, Chaillot est devenu un des faubourgs de la capitale, sous le nom de faubourg de la Conférence. Mais cet excès d’honneur ne l’a point enivré. Le hameau est resté campagnard à la ville : il a gardé son nom rustique, son aspect villageois ; et bien que le commerce et l’industrie l’envahissent de toutes parts et menacent d’en chasser bientôt tout silence et toute poésie, c’est encore un asile où les âmes fatiguées peuvent se faire, aux portes de Paris, une vie calme et pleine de loisirs.
Chaillot fut de bonne heure érigé en paroisse : en 1097, cette cure appartenait au prieuré de Saint-Martin-des-Champs. En 1450, à l’extinction des seigneurs particuliers de cette terre, elle passa sous la domination des seigneurs de Marly-le-Château ; mais le roi en conserva la haute-justice, dont il se démit en faveur de son chambellan, Philippe de Comines. La haute-justice de Chaillot revint à la couronne ; mais en 1633 elle appartenait encore au maréchal de Bassompierre, et plus tard nous la voyons passer aux religieuses de la Visitation.
La Marraine chapitre De l’amour - La Revue de Paris, 15 mai 1895
Ma marraine parlait à M. Lesec. Elle disait :
— L’amour ? L’amour de l’homme pour la femme, je ne sais ce que c’est et j’ai toujours pensé que c’était bien peu de chose. Mais l’amour de la femme ! cet amour qui, né dans le silence, s’est glissé mystérieusement dans son sein, ignoré de celui qui l’inspira, ignoré de celle même qui l’éprouve, qui bientôt, grandissant, comme un enfant capricieux et mutin, fait naître les soucis et les larmes, qui, jaloux, injuste, exigeant, mais encore caché, commence à se révéler seulement au cœur qu’il ronge et qu’il asservit, qui chaque jour croît dans le secret des plus intimes pensées, s’insinue, pénètre comme un poison, breuvage funeste, mais enivrant, qu’on savoure sans prudence et qui bientôt après dévore les entrailles et, comme un feu liquide, court de veine en veine avec le sang et la vie !… ô femmes, s’il en est parmi vous quelqu’une qui ne l’ait jamais ressenti, cet amour brûlant, qu’elle n’ose pas s’en vanter ou qu’elle se vante de n’être pas femme ! Stérile de cœur, elle a passé comme une fleur sans éclat, sans parfum et sans fruit. Vide de souvenirs, elle n’a connu de la vie ni les cuisantes douleurs, ni les joies délirantes. Insensible et nulle, elle n’a eu de son sexe ni les misérables faiblesses, ni les héroïques passions !
» La femme qui aime est de tous les êtres le plus courageux, le plus magnanime, le plus constant, le plus dévoué. Demandez-lui tout ce qui est grand, tout ce qui est énergique, tout ce qui semble au-dessus des forces humaines et des penchants de la nature ; vous l’obtiendrez, car sa passion fait d’elle une fanatique prête au martyre, une sainte digne du ciel ; mais ne lui demandez pas le sang de l’innocent, car elle vous le donnerait, ne lui prescrivez pas le vice, le déshonneur, la trahison, l’adultère car elle vous obéirait, et, d’un ange de Dieu, vous feriez un démon du mal.
George Sand aux riches Suivi d’une note signée « Les Icariens » - Imp. Laroche-Jacob, Sedan, 1848
« La grande crainte, ou le grand prétexte de l’aristocratie à l’heure qu’il est, c’est l’idée Communiste. S’il y avait moyen de rire dans un temps si sérieux, cette frayeur aurait de quoi nous divertir. Sous ce mot de Communisme, on sous-entend le peuple, ses besoins, ses aspirations. Ne confondons point : le Peuple, c’est le Peuple ; le Communisme, c’est l’avenir calomnié et incompris du Peuple.
» La ruse est ici fort inutile ; c’est le peuple qui vous gêne et vous inquiète ; c’est la république dont vous craignez le développement. C’est le droit de tous que vous ne supportez pas sans malaise et sans dépit. Un peu de réflexion vous remettrait pourtant l’esprit. La conquête que le peuple a faite de son droit vous arrache-t-elle donc des mains le droit que vous exerciez ? Vous croyez-vous sous le régime de la Terreur ? Avons-nous demandé la tête du roi, de la reine, des princes et princesses ? Avons-nous rasé les châteaux, persécuté les prêtres ? Demandons-nous la loi agraire ?
» D’ailleurs, outre que les fatales nécessités du passé n’existent plus et qu’il serait impolitique de faire des victimes, vous nous outragez, vous nous calomniez ; vous vous rabaissez vous-mêmes, si vous niez que, depuis plus d’un demi-siècle, nous ne soyons pas devenus plus humains, plus sages, plus éclairés, plus religieux. Prenez garde, la peur que vous avez nous prouve peu de confiance en vous-mêmes, et si vous méconnaissez le progrès que nous avons pu faire, vous révélez que vous n’en avez fait aucun.
Critique de La Case de l’oncle Tom - 1852
Ce livre est dans toutes les mains, dans tous les journaux. Il aura, il a déjà des éditions dans tous les formats. On le dévore, on le couvre de larmes. Il n’est déjà plus permis aux personnes qui savent lire de ne pas l’avoir lu, et on regrette qu’il y ait tant de gens condamnés à ne le lire jamais : ilotes par la misère, esclaves par l’ignorance, pour lesquels les lois politiques ont été impuissantes jusqu’à ce jour à résoudre le double problème du pain de l’âme et du pain du corps.
La Fauvette du docteur - J. Hetzel, Paris, 1852
Nous avions pour hôte à la campagne, il y a quelques années, un vieux docteur que nous aimions, bien qu’il fût insupportable, parce qu’il avait du bon malgré ses manies. Entre autres maussades habitudes, il fuyait la société des femmes. On eût dit qu’il les haïssait, et pourtant la cause de leur émancipation avait en lui un défenseur opiniâtre. Il semblait qu’il se réservât pour le temps où elles seraient dignes d’être admises à l’égalité sociale, car il ne voulut jamais se marier, et lorsque, pour le taquiner, on le lui conseillait, il répondait avec un sérieux admirable : « Plus tard, plus tard ; il n’est pas encore temps pour moi. » Or, il avait quatre-vingt-deux ans. Huit jours avant sa mort, il nous parut tout gai, tout rajeuni, et comme nous en faisions la remarque, il nous déclara, d’un air enjoué, qu’il avait enfin trouvé la compagne de sa vie, et qu’il se sentait véritablement épris, d’autant plus qu’il se croyait parfaitement aimé. Comme rien dans sa vie de cénobite ne nous parut changé, nous prîmes cet excès de fatuité pour une des rares facéties qui déridaient, une ou deux fois par an, son front chagrin. Un matin, il ne vint pas déjeuner, nous allâmes le chercher, et nous le trouvâmes penché et comme assoupi sur ses livres. Un petit oiseau voltigeait dans sa chambre, dont la fenêtre ouverte laissait tomber sur son vieux crâne les rayons joyeux du soleil de juin. Il était mort.
Les On-dit du Rappel - 14 mai 1876
Sous ce titre : la Science du mécanisme vocal et l’art du chant, Mme Andréa Lacombe publie un livre que nous ne saurions mieux recommander aux amis de la musique qu’en citant les deux lettres suivantes qu’il a values à son auteur.
La Fée qui court - Figaro : journal non politique, 4 juillet 1877 (Un charmant petit conte de George Sand )
Je rencontrai l’autre jour une bonne fée qui courait comme une folle, malgré son grand âge.
À propos du banquet shakespearien - Le Temps - 24 avril 1864
La lettre suivante, de George Sand, était destinée à être lue aujourd’hui, au banquet de Shakespeare