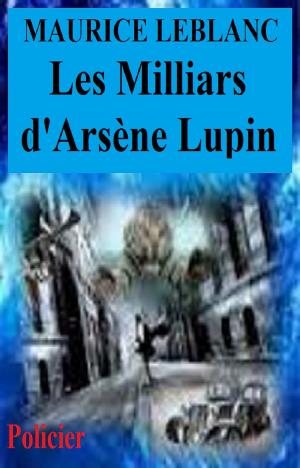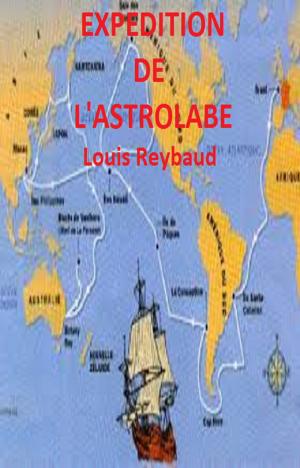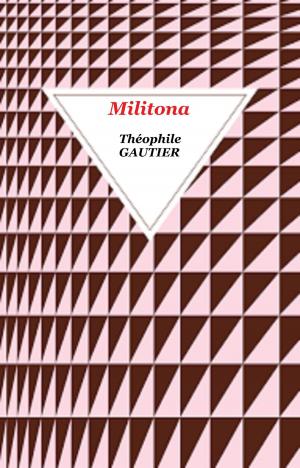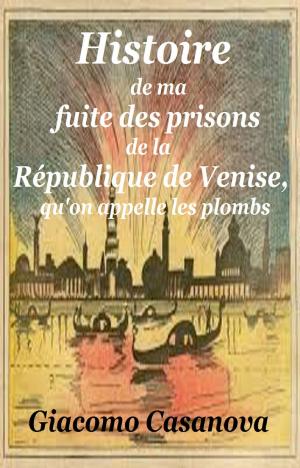| Author: | GEORGE SAND | ISBN: | 1230002752488 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 28, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | GEORGE SAND |
| ISBN: | 1230002752488 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 28, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
M. de Flamarande s’était imposé la tâche de venir voir sa femme et son fils deux fois par an, l’hiver à Paris, l’été à Ménouville. Lorsqu’il y vint en 1856, il me dit :
— Je sais, Charles, que vous vivez à présent de pair à compagnon avec mon fils et sa mère. Je n’y trouve point à redire. Comme je ne veux pas que les plaisirs du monde pénètrent ici et que j’ai réglé la dépense annuelle en conséquence, je ne suis pas fâché qu’on sache ne point s’ennuyer dans son intérieur. Une vie plus dissipée, ajoutée à la dissipation naturelle de Roger, rendrait son éducation impossible. Quant à vous, plus vous verrez de près ce qui se passe, plus je serai tranquille. Vous ne me dites plus tout ce que vous savez. Je ne vous le demande pas, mais je suis certain que vous sauriez empêcher des entrevues irrégulières. Ne me répondez pas ; je sais que l’enfant de Flamarande et sa mère ne sont plus étrangers l’un à l’autre. Je sais, bien que vous m’en ayez fait mystère, que le père élève le fils, et que par conséquent on n’a pas la prétention de me l’imposer. Tout est bien ainsi, on me donne la satisfaction qui m’était due et que je souhaitais. Laissez donc toute liberté aux entrevues de Flamarande ou d’ailleurs ; pourvu que ni le père ni le fils ne paraissent jamais chez moi, je n’en demande pas davantage.
M. de Flamarande ne me permit pas de répondre, et s’en alla comme de coutume en raillant Roger de son ignorance et de sa légèreté.
La vie que l’on menait à Ménouville était fort restreinte. Monsieur avait effectivement fixé le chiffre de la dépense. Il ne voulait pas, disait-il, encourager les fantaisies de Roger et laisser le champ libre aux gâteries de sa mère. Madame ne se plaignait jamais de rien et se privait gaiement de tout pour mettre au service de son fils toutes ses ressources personnelles, qui n’étaient pas considérables. Je trichais un peu à leur insu pour que Roger pût avoir chevaux et chiens sans que la mère fît trop retourner ses robes et relustrer ses rubans. J’avais su mettre assez d’ordre dans ma gestion pour que M. le comte trouvât de l’amélioration dans ses recettes sans se douter que certains excédants payaient les amusements de Roger et les charités de madame. Elle l’ignorait, car elle s’y fût refusée en ce qui la concernait. Quelquefois elle paraissait étonnée, après avoir tout donné, d’avoir encore quelque chose ; mais elle n’y connaissait rien. Son mari l’avait tenue en tutelle au point qu’elle ne savait pas mieux calculer qu’un enfant.
Roger, tout en ne travaillant rien, apprenait pourtant beaucoup de choses. Il ne mordit jamais aux mathématiques et aux sciences abstraites. Il n’avait pas non plus de goût pour les sciences naturelles, mais il aimait la musique et la littérature, il lisait volontiers l’histoire et apprenait les langues vivantes avec une admirable facilité. Sa mémoire lui tenait lieu de grammaire, comme son instinct musical de théorie. Très-bien doué, il plaisait tellement qu’on ne songeait pas à lui demander d’acquérir. Il acquérait pourtant dans la sphère de ses tendances par l’insufflation patiente et enjouée de sa mère, qui savait si bien l’instruire en l’amusant. Quand je lui exprimais mon admiration :
— Je n’y ai aucun mérite, me répondait-elle. Il est si tendre et si aimable, si pur et si aimant, qu’on est payé au centuple de la peine qu’on se donne pour lui.
Cependant les passions commençaient à parler, et elles annonçaient devoir être d’autant plus vives que l’enfant avait vécu dans une atmosphère plus chaste. À un voyage que je fis dans l’hiver à Paris pour les affaires de la famille, je découvris des choses dont madame ne se doutait pas encore. À dix-neuf ans, mon Roger découchait déjà de temps en temps ; entraîné par des petites moustaches de son âge, il jouait gros jeu et nouait des relations plus que légères à l’insu des parents. Il fut forcé de me l’avouer ; je n’étais pas de ceux qu’on trompe. J’eus à payer quelques dettes que je ne pouvais faire figurer sur mes comptes et dont je lui avançai le montant sur mes économies ; elles étaient très-minces, et il comprit qu’il n’y pouvait recourir souvent. Il jura de se corriger, tout en pleurant et m’embrassant. Il me bénissait surtout de lui garder le secret vis-à-vis de sa mère ; tout ce qu’il craignait au monde, c’était de lui faire de la peine.
Cette candeur de repentir s’effaça vite, et je vis bien, l’été suivant, que de nouvelles folies n’avaient pu être cachées à madame. Elle avait payé sans reproche, mais elle avait dit :
— Je ne suis pas riche ; quand je n’aurai plus rien, que feras-tu ?
Je vis madame si gênée que je me décidai à écrire à M. de Flamarande pour lui remontrer qu’un jeune homme de vingt ans, destiné à être l’unique héritier d’une grande fortune, ne pouvait pas vivre comme un petit bourgeois de campagne, et qu’à mon avis M. le vicomte devrait commencer à toucher une pension convenable. Monsieur me répondit qu’il ne ferait pas de pension avant l’âge de vingt et un ans révolus ; mais il trouvait nécessaire que Roger voyageât pendant une année pour voir et connaître le monde. Il ordonna qu’il eût à partir sur-le-champ pour l’Allemagne, et il traça un itinéraire détaillé que l’abbé Ferras devait suivre à la lettre. C’est lui qu’il chargeait de la dépense, et il en fixait le chiffre, qui était assez large, mais nullement élastique. Tout ce qui le dépasserait serait à la charge du gouverneur. M. de Flamarande n’appelait aucunement son fils à Londres ; il lui donnait des lettres de crédit et de recommandation pour Berlin, Vienne, la Russie, Constantinople et l’Italie. Au bout d’un an juste, il fallait être rentré à Ménouville, où M. le comte espérait que madame resterait durant l’absence de son fils.
M. de Flamarande s’était imposé la tâche de venir voir sa femme et son fils deux fois par an, l’hiver à Paris, l’été à Ménouville. Lorsqu’il y vint en 1856, il me dit :
— Je sais, Charles, que vous vivez à présent de pair à compagnon avec mon fils et sa mère. Je n’y trouve point à redire. Comme je ne veux pas que les plaisirs du monde pénètrent ici et que j’ai réglé la dépense annuelle en conséquence, je ne suis pas fâché qu’on sache ne point s’ennuyer dans son intérieur. Une vie plus dissipée, ajoutée à la dissipation naturelle de Roger, rendrait son éducation impossible. Quant à vous, plus vous verrez de près ce qui se passe, plus je serai tranquille. Vous ne me dites plus tout ce que vous savez. Je ne vous le demande pas, mais je suis certain que vous sauriez empêcher des entrevues irrégulières. Ne me répondez pas ; je sais que l’enfant de Flamarande et sa mère ne sont plus étrangers l’un à l’autre. Je sais, bien que vous m’en ayez fait mystère, que le père élève le fils, et que par conséquent on n’a pas la prétention de me l’imposer. Tout est bien ainsi, on me donne la satisfaction qui m’était due et que je souhaitais. Laissez donc toute liberté aux entrevues de Flamarande ou d’ailleurs ; pourvu que ni le père ni le fils ne paraissent jamais chez moi, je n’en demande pas davantage.
M. de Flamarande ne me permit pas de répondre, et s’en alla comme de coutume en raillant Roger de son ignorance et de sa légèreté.
La vie que l’on menait à Ménouville était fort restreinte. Monsieur avait effectivement fixé le chiffre de la dépense. Il ne voulait pas, disait-il, encourager les fantaisies de Roger et laisser le champ libre aux gâteries de sa mère. Madame ne se plaignait jamais de rien et se privait gaiement de tout pour mettre au service de son fils toutes ses ressources personnelles, qui n’étaient pas considérables. Je trichais un peu à leur insu pour que Roger pût avoir chevaux et chiens sans que la mère fît trop retourner ses robes et relustrer ses rubans. J’avais su mettre assez d’ordre dans ma gestion pour que M. le comte trouvât de l’amélioration dans ses recettes sans se douter que certains excédants payaient les amusements de Roger et les charités de madame. Elle l’ignorait, car elle s’y fût refusée en ce qui la concernait. Quelquefois elle paraissait étonnée, après avoir tout donné, d’avoir encore quelque chose ; mais elle n’y connaissait rien. Son mari l’avait tenue en tutelle au point qu’elle ne savait pas mieux calculer qu’un enfant.
Roger, tout en ne travaillant rien, apprenait pourtant beaucoup de choses. Il ne mordit jamais aux mathématiques et aux sciences abstraites. Il n’avait pas non plus de goût pour les sciences naturelles, mais il aimait la musique et la littérature, il lisait volontiers l’histoire et apprenait les langues vivantes avec une admirable facilité. Sa mémoire lui tenait lieu de grammaire, comme son instinct musical de théorie. Très-bien doué, il plaisait tellement qu’on ne songeait pas à lui demander d’acquérir. Il acquérait pourtant dans la sphère de ses tendances par l’insufflation patiente et enjouée de sa mère, qui savait si bien l’instruire en l’amusant. Quand je lui exprimais mon admiration :
— Je n’y ai aucun mérite, me répondait-elle. Il est si tendre et si aimable, si pur et si aimant, qu’on est payé au centuple de la peine qu’on se donne pour lui.
Cependant les passions commençaient à parler, et elles annonçaient devoir être d’autant plus vives que l’enfant avait vécu dans une atmosphère plus chaste. À un voyage que je fis dans l’hiver à Paris pour les affaires de la famille, je découvris des choses dont madame ne se doutait pas encore. À dix-neuf ans, mon Roger découchait déjà de temps en temps ; entraîné par des petites moustaches de son âge, il jouait gros jeu et nouait des relations plus que légères à l’insu des parents. Il fut forcé de me l’avouer ; je n’étais pas de ceux qu’on trompe. J’eus à payer quelques dettes que je ne pouvais faire figurer sur mes comptes et dont je lui avançai le montant sur mes économies ; elles étaient très-minces, et il comprit qu’il n’y pouvait recourir souvent. Il jura de se corriger, tout en pleurant et m’embrassant. Il me bénissait surtout de lui garder le secret vis-à-vis de sa mère ; tout ce qu’il craignait au monde, c’était de lui faire de la peine.
Cette candeur de repentir s’effaça vite, et je vis bien, l’été suivant, que de nouvelles folies n’avaient pu être cachées à madame. Elle avait payé sans reproche, mais elle avait dit :
— Je ne suis pas riche ; quand je n’aurai plus rien, que feras-tu ?
Je vis madame si gênée que je me décidai à écrire à M. de Flamarande pour lui remontrer qu’un jeune homme de vingt ans, destiné à être l’unique héritier d’une grande fortune, ne pouvait pas vivre comme un petit bourgeois de campagne, et qu’à mon avis M. le vicomte devrait commencer à toucher une pension convenable. Monsieur me répondit qu’il ne ferait pas de pension avant l’âge de vingt et un ans révolus ; mais il trouvait nécessaire que Roger voyageât pendant une année pour voir et connaître le monde. Il ordonna qu’il eût à partir sur-le-champ pour l’Allemagne, et il traça un itinéraire détaillé que l’abbé Ferras devait suivre à la lettre. C’est lui qu’il chargeait de la dépense, et il en fixait le chiffre, qui était assez large, mais nullement élastique. Tout ce qui le dépasserait serait à la charge du gouverneur. M. de Flamarande n’appelait aucunement son fils à Londres ; il lui donnait des lettres de crédit et de recommandation pour Berlin, Vienne, la Russie, Constantinople et l’Italie. Au bout d’un an juste, il fallait être rentré à Ménouville, où M. le comte espérait que madame resterait durant l’absence de son fils.