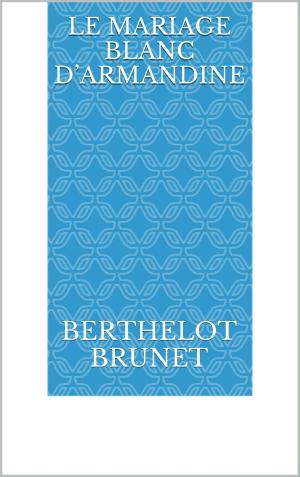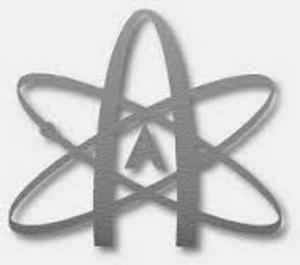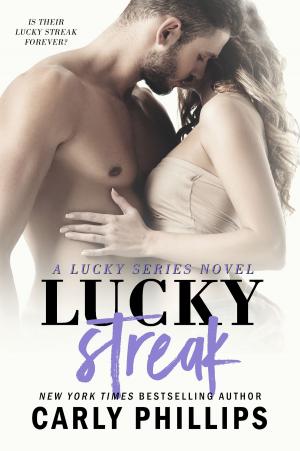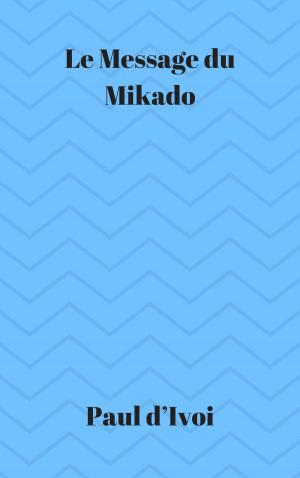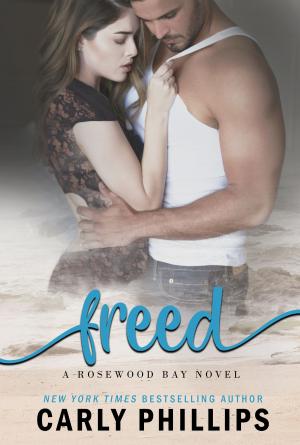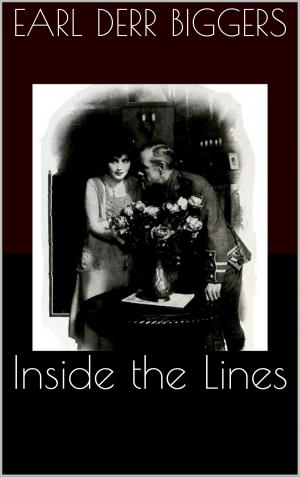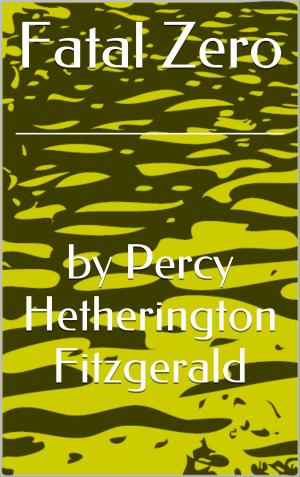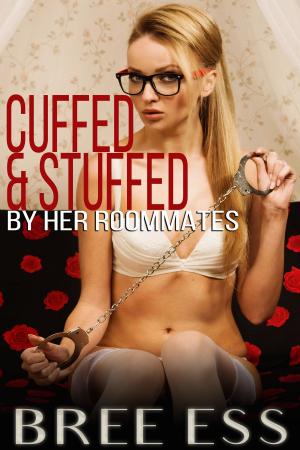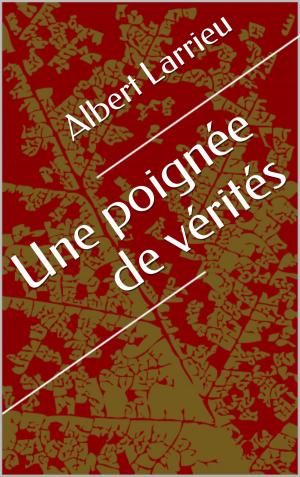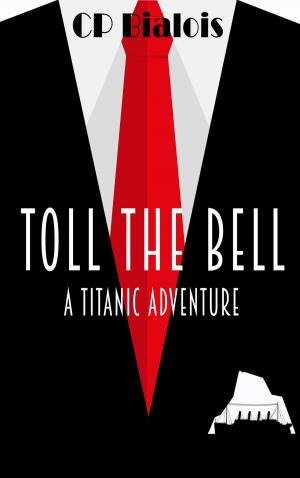Ma double vie Mémoires de Sarah Bernhardt
Biography & Memoir, Artists, Architects & Photographers, Nonfiction, Art & Architecture, Entertainment & Performing Arts| Author: | Sarah Bernhardt | ISBN: | 1230001213645 |
| Publisher: | CP | Publication: | July 3, 2016 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Sarah Bernhardt |
| ISBN: | 1230001213645 |
| Publisher: | CP |
| Publication: | July 3, 2016 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Ma mère adorait voyager. Elle allait d’Espagne en Angleterre ; de Londres à Paris ; de Paris à Berlin. De là, à Christiania ; puis revenait m’embrasser et repartait pour la Hollande, son pays natal.
Elle envoyait à ma nourrice : des vêtements pour elle, et des gâteaux pour moi.
Elle écrivait à une de mes tantes : « Veille sur la petite Sarah, je reviendrai dans un mois. » Elle écrivait à une autre de ses sœurs, un mois après : « Va voir l’enfant chez sa nourrice, je reviens dans quinze jours. »
Ma mère avait dix-neuf ans, j’en avais trois ; et mes tantes avaient : l’une dix-sept ans, l’autre vingt ans. Une autre avait quinze ans, et l’aînée vingt-huit ans ; mais cette dernière habitait la Martinique et avait déjà six enfants.
Ma grand’mère était aveugle. Mon grand-père était mort ; et mon père était en Chine depuis deux ans. Pourquoi ? Je n’en sais rien.
Mes jeunes tantes promettaient de venir me voir, et ne tenaient guère leur parole.
Ma nourrice était bretonne et habitait près de Quimperlé une petite maison blanche, au toit de chaume très bas, sur lequel poussaient des giroflées sauvages.
C’est la première fleur qui ait charmé mes yeux d’enfant. Et je l’ai toujours adorée, cette fleur aux pétales faits de soleil couchant, aux feuilles drues et tristes.
C’est loin, la Bretagne, même à notre époque de vélocité. C’était alors le bout du monde.
Heureusement, ma nourrice était, paraît-il, une brave femme. Et, son enfant étant mort, je restai seule à être aimée. Mais elle aimait comme aiment les gens pauvres : quand ils ont le temps.
Un jour, l’homme étant malade, elle était allée aux champs pour aider à la récolte des pommes de terre ; le sol trop mouillé les pourrissait. Le travail pressait. Elle me confia à la garde de son mari, étendu sur sa couchette bretonne, les reins cloués par un lumbago. La brave femme m’avait installée dans ma chaise haute. Elle eut soin de mettre la cheville de bois qui tenait devant moi la tablette étroite sur laquelle elle posa de menus jouets. Elle jeta un sarment dans la cheminée et me dit en breton (jusqu’à l’âge de quatre ans je n’ai compris que le breton) : (Tu seras sage, Fleur-de-Lait ? » (C’était le seul nom auquel je répondais alors.)
La brave femme partie, je m’efforçai de retirer la cheville de bois mise avec tant de soin par ma pauvre nourrice. Ayant enfin réussi, je poussai le petit rempart, croyant — pauvre de moi — m’élancer sur le sol ; et je tombai dans le feu qui crépitait joyeusement. Les cris de mon père nourricier qui ne pouvait bouger, attirèrent les voisins. On me jeta toute fumante dans un grand seau de lait qui venait d’être tiré.
Ma mère adorait voyager. Elle allait d’Espagne en Angleterre ; de Londres à Paris ; de Paris à Berlin. De là, à Christiania ; puis revenait m’embrasser et repartait pour la Hollande, son pays natal.
Elle envoyait à ma nourrice : des vêtements pour elle, et des gâteaux pour moi.
Elle écrivait à une de mes tantes : « Veille sur la petite Sarah, je reviendrai dans un mois. » Elle écrivait à une autre de ses sœurs, un mois après : « Va voir l’enfant chez sa nourrice, je reviens dans quinze jours. »
Ma mère avait dix-neuf ans, j’en avais trois ; et mes tantes avaient : l’une dix-sept ans, l’autre vingt ans. Une autre avait quinze ans, et l’aînée vingt-huit ans ; mais cette dernière habitait la Martinique et avait déjà six enfants.
Ma grand’mère était aveugle. Mon grand-père était mort ; et mon père était en Chine depuis deux ans. Pourquoi ? Je n’en sais rien.
Mes jeunes tantes promettaient de venir me voir, et ne tenaient guère leur parole.
Ma nourrice était bretonne et habitait près de Quimperlé une petite maison blanche, au toit de chaume très bas, sur lequel poussaient des giroflées sauvages.
C’est la première fleur qui ait charmé mes yeux d’enfant. Et je l’ai toujours adorée, cette fleur aux pétales faits de soleil couchant, aux feuilles drues et tristes.
C’est loin, la Bretagne, même à notre époque de vélocité. C’était alors le bout du monde.
Heureusement, ma nourrice était, paraît-il, une brave femme. Et, son enfant étant mort, je restai seule à être aimée. Mais elle aimait comme aiment les gens pauvres : quand ils ont le temps.
Un jour, l’homme étant malade, elle était allée aux champs pour aider à la récolte des pommes de terre ; le sol trop mouillé les pourrissait. Le travail pressait. Elle me confia à la garde de son mari, étendu sur sa couchette bretonne, les reins cloués par un lumbago. La brave femme m’avait installée dans ma chaise haute. Elle eut soin de mettre la cheville de bois qui tenait devant moi la tablette étroite sur laquelle elle posa de menus jouets. Elle jeta un sarment dans la cheminée et me dit en breton (jusqu’à l’âge de quatre ans je n’ai compris que le breton) : (Tu seras sage, Fleur-de-Lait ? » (C’était le seul nom auquel je répondais alors.)
La brave femme partie, je m’efforçai de retirer la cheville de bois mise avec tant de soin par ma pauvre nourrice. Ayant enfin réussi, je poussai le petit rempart, croyant — pauvre de moi — m’élancer sur le sol ; et je tombai dans le feu qui crépitait joyeusement. Les cris de mon père nourricier qui ne pouvait bouger, attirèrent les voisins. On me jeta toute fumante dans un grand seau de lait qui venait d’être tiré.