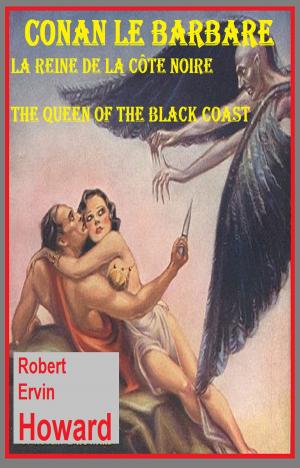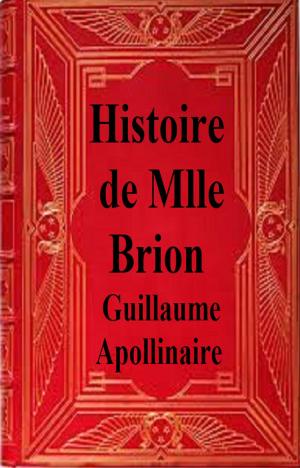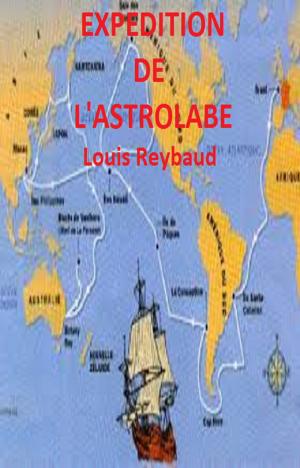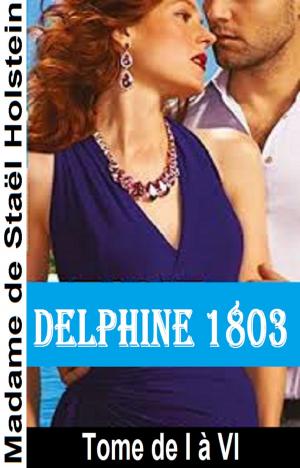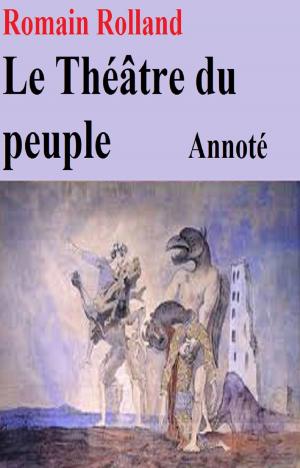| Author: | EMILE BERGERAT | ISBN: | 1230002995687 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | December 17, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | EMILE BERGERAT |
| ISBN: | 1230002995687 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | December 17, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Tome II
Lorsque les Juifs, dit la Bible, arrivèrent devant Chanaan, ils devinrent comme fous à la vue des raisins monstrueux de la Terre Promise. Un ânier qui rentrait à Sidon avec une charge d’olives se mit à rire de leur exaltation. — Prodigieuses, dites-vous, les baies de nos pampres ? Mais il y en a tant ici que nous les laissons perdre et ce sont nos oiseaux et nos pauvres qui les mangent !
D’ailleurs Paris contient encore beaucoup plus d’autochtones qu’on ne l’imagine — le recensement en cours peut en fixer le nombre — sinon ataviques, du moins assimilés depuis longtemps et fondus dans la race. Tout se charge de cette fusion, le climat y aide aux lois, les lois aux mœurs, et c’est ici que triomphe cette théorie des milieux que Darwin n’a fait qu’emprunter à la nature même.
Avez-vous observé qu’il n’en va pas ainsi dans les autres « Babylones », car enfin il y a d’autres Babylones que la nôtre à foudroyer des Père-Lachaise. À Londres, un transplanté ne devient jamais un Londonien, ni à Berlin un Berlinois, et si, dans sa grande cuve d’immigration, New York mêle tous les types de la famille humaine, elle en fait des Américains, mais non des New Yorkais. À Paris, les plantes exotiques reprennent racine et rendent floraison : un Henri Heine y devient aussi parisien que Voltaire. On n’exile pas à Paris, et pour cause.
Paris qui n’est à personne est par cela même à tout le monde. Il ne reste qu’à le prendre. Or pour le prendre il n’est que deux moyens, pas d’autres, le travail et la gaieté — tous ses aborigènes le savent, tous ses naturalisés le disent — et le reste est blague et temps perdu. S’il y a Babylone, c’est Babylone de labeur, avec cette dominante que la besogne y chante, que la tâche y rit et que l’effort ne s’en fait pas accroire. Dans cet Etna la bonne humeur signe le livret des Cyclopes.
Aujourd’hui encore, au bout de cinquante années d’exercice, ma foi là-dessus reste entière. Paris est aux laborieux allègres, il n’est qu’à eux, et, tant que la Seine reflétera entre ses ponts Notre-Dame, le Palais de Justice et l’Arc, rien ne sera changé à la loi ethnique et climatérique qui leur assure le pain d’épeautre, le vin de coteaux, et des fleurs pour leurs amours.
Jusqu’à la mort de Théophile Gautier — 23 octobre 1872 — nous occupions, ma chère femme et moi, le second étage de la maison de la rue de Longchamp, c’est-à-dire l’atelier-bibliothèque qu’il y avait fait aménager. Cette cohabitation avait été la condition fondamentale du mariage, le pauvre père ne se résignant nullement à se séparer de sa fille selon des usages « occidentaux » que ne ratifie pas la nature.
Cet atelier, il nous l’avait d’ailleurs meublé, d’abord d’un lit en riche pitchpin, à montants de bambou, et d’une armoire à glace de même style Second Empire qu’il était allé chercher lui-même au faubourg Saint-Antoine, et, pour le reste, la jeune épousée y avait transporté ses effets et bibelots de jeune fille. Et c’était tout, mais en fallait-il davantage ? Le palais était en nous.
Le soir des obsèques nous n’y voulûmes pas rentrer. Hélas, il n’était que trop rompu le pacte de la cohabitation. Les sœurs du poète s’étaient elles-mêmes sauvées à Montrouge, où elles possédaient une maison héréditaire, elles y avaient emporté les chats, lares du logis ; la tente vide claquait des toiles au vent d’automne.
Nous trouvâmes d’abord asile à Villiers-sur-Marne, où la mère des deux filles du maître s’était retirée, depuis longtemps, en un petit pavillon, construit d’ailleurs par Charles Garnier ; elle s’y adonnait à la sériciculture. Tous les murs étaient revêtus de casiers à vers à soie, qui y opéraient leur lente métamorphose. Comme le jardin d’alentour abondait en mûriers, Ernesta Grisi était parvenue à tirer un petit revenu de cet élevage. Au demeurant, elle avait des poules, des lapins, des pigeons, et elle terminait en fermière une vie commencée sous le lustre du Théâtre-Italien à la grande époque de Rubini et Lablache.
Cette bonne et naïve créature avait été douée d’un contralto extraordinaire. Je la décidais de temps en temps à chanter pour nous, à chambre close, et je me demande encore comment de toute cette famille célèbre des Grisi, elle fut la seule qui n’attela point la fortune ? Je l’avais conquise à mes amours par ma ressemblance, disait-elle, avec Mario, son noble cousin, duc de Candia, et l’époux morganatique de Julia Grisi. Lorsque pour me taquiner Théophile Gautier me criait si drôlement : « Fais-toi ténor… Pourquoi ne te fais-tu pas ténor ? » Ernesta Grisi l’appuyait maternellement. « Soyez ténor, Émile ! » Mais je la regardais, la petite fermière, et j’entendais les vers à soie tisser sa maisonnette solitaire.
Ce fut Catulle Mendès qui nous dénicha, rue de Trévise, un appartement à peu près, comme on dit, dans nos moyens, en langue de locataire. Oh ! l’incroyable appartement ! Il se composait d’abord d’un escalier intérieur, tournant comme ceux des restaurants, et dont le tire-bouchon concluait la cage du grand escalier de l’habitacle. Ce « Piranèse » nous était propre et le concierge lui-même n’y avait accès qu’en tirant la sonnette. Il menait à trois chambres sans portes, en enfilade, et de plafond si basses qu’un huissier malappris y eût salué tout seul automatiquement, faute d’y pouvoir garder son chapeau sur la tête. Ces trois chambres n’étaient séparées du couloir de service, où s’ouvraient les logis des domestiques de l’immeuble, que par une cloison planchéiée au travers de laquelle sonnaient les moindres bruits de corridor. Pour la cuisine, elle était dans le « Piranèse ».
— Vous serez là comme des anges, nous avait dit Catulle, au centre de la ville, et le petit escalier est à lui seul une merveille !
— Nous en ferons notre salon ! m’écriai-je, emballé par son enthousiasme.
Et nous allâmes chercher notre mobilier à Neuilly. Il n’y fallut qu’un seul voyage et une voiture à bras, louée à un auverpin du quartier. Mais si le lit, démonté, passait dans le « Piranèse », l’armoire à glace n’y passait point. Il résistait, ou c’était elle ; mais l’un ou l’autre. Sous les traits toujours souriants d’Armand Silvestre, la Providence vint à notre aide.
— Démembrons l’armoire à glace ! Les trois cents Grecs de Léonidas n’allaient que un par un dans le défilé des Thermopyles !
Tome II
Lorsque les Juifs, dit la Bible, arrivèrent devant Chanaan, ils devinrent comme fous à la vue des raisins monstrueux de la Terre Promise. Un ânier qui rentrait à Sidon avec une charge d’olives se mit à rire de leur exaltation. — Prodigieuses, dites-vous, les baies de nos pampres ? Mais il y en a tant ici que nous les laissons perdre et ce sont nos oiseaux et nos pauvres qui les mangent !
D’ailleurs Paris contient encore beaucoup plus d’autochtones qu’on ne l’imagine — le recensement en cours peut en fixer le nombre — sinon ataviques, du moins assimilés depuis longtemps et fondus dans la race. Tout se charge de cette fusion, le climat y aide aux lois, les lois aux mœurs, et c’est ici que triomphe cette théorie des milieux que Darwin n’a fait qu’emprunter à la nature même.
Avez-vous observé qu’il n’en va pas ainsi dans les autres « Babylones », car enfin il y a d’autres Babylones que la nôtre à foudroyer des Père-Lachaise. À Londres, un transplanté ne devient jamais un Londonien, ni à Berlin un Berlinois, et si, dans sa grande cuve d’immigration, New York mêle tous les types de la famille humaine, elle en fait des Américains, mais non des New Yorkais. À Paris, les plantes exotiques reprennent racine et rendent floraison : un Henri Heine y devient aussi parisien que Voltaire. On n’exile pas à Paris, et pour cause.
Paris qui n’est à personne est par cela même à tout le monde. Il ne reste qu’à le prendre. Or pour le prendre il n’est que deux moyens, pas d’autres, le travail et la gaieté — tous ses aborigènes le savent, tous ses naturalisés le disent — et le reste est blague et temps perdu. S’il y a Babylone, c’est Babylone de labeur, avec cette dominante que la besogne y chante, que la tâche y rit et que l’effort ne s’en fait pas accroire. Dans cet Etna la bonne humeur signe le livret des Cyclopes.
Aujourd’hui encore, au bout de cinquante années d’exercice, ma foi là-dessus reste entière. Paris est aux laborieux allègres, il n’est qu’à eux, et, tant que la Seine reflétera entre ses ponts Notre-Dame, le Palais de Justice et l’Arc, rien ne sera changé à la loi ethnique et climatérique qui leur assure le pain d’épeautre, le vin de coteaux, et des fleurs pour leurs amours.
Jusqu’à la mort de Théophile Gautier — 23 octobre 1872 — nous occupions, ma chère femme et moi, le second étage de la maison de la rue de Longchamp, c’est-à-dire l’atelier-bibliothèque qu’il y avait fait aménager. Cette cohabitation avait été la condition fondamentale du mariage, le pauvre père ne se résignant nullement à se séparer de sa fille selon des usages « occidentaux » que ne ratifie pas la nature.
Cet atelier, il nous l’avait d’ailleurs meublé, d’abord d’un lit en riche pitchpin, à montants de bambou, et d’une armoire à glace de même style Second Empire qu’il était allé chercher lui-même au faubourg Saint-Antoine, et, pour le reste, la jeune épousée y avait transporté ses effets et bibelots de jeune fille. Et c’était tout, mais en fallait-il davantage ? Le palais était en nous.
Le soir des obsèques nous n’y voulûmes pas rentrer. Hélas, il n’était que trop rompu le pacte de la cohabitation. Les sœurs du poète s’étaient elles-mêmes sauvées à Montrouge, où elles possédaient une maison héréditaire, elles y avaient emporté les chats, lares du logis ; la tente vide claquait des toiles au vent d’automne.
Nous trouvâmes d’abord asile à Villiers-sur-Marne, où la mère des deux filles du maître s’était retirée, depuis longtemps, en un petit pavillon, construit d’ailleurs par Charles Garnier ; elle s’y adonnait à la sériciculture. Tous les murs étaient revêtus de casiers à vers à soie, qui y opéraient leur lente métamorphose. Comme le jardin d’alentour abondait en mûriers, Ernesta Grisi était parvenue à tirer un petit revenu de cet élevage. Au demeurant, elle avait des poules, des lapins, des pigeons, et elle terminait en fermière une vie commencée sous le lustre du Théâtre-Italien à la grande époque de Rubini et Lablache.
Cette bonne et naïve créature avait été douée d’un contralto extraordinaire. Je la décidais de temps en temps à chanter pour nous, à chambre close, et je me demande encore comment de toute cette famille célèbre des Grisi, elle fut la seule qui n’attela point la fortune ? Je l’avais conquise à mes amours par ma ressemblance, disait-elle, avec Mario, son noble cousin, duc de Candia, et l’époux morganatique de Julia Grisi. Lorsque pour me taquiner Théophile Gautier me criait si drôlement : « Fais-toi ténor… Pourquoi ne te fais-tu pas ténor ? » Ernesta Grisi l’appuyait maternellement. « Soyez ténor, Émile ! » Mais je la regardais, la petite fermière, et j’entendais les vers à soie tisser sa maisonnette solitaire.
Ce fut Catulle Mendès qui nous dénicha, rue de Trévise, un appartement à peu près, comme on dit, dans nos moyens, en langue de locataire. Oh ! l’incroyable appartement ! Il se composait d’abord d’un escalier intérieur, tournant comme ceux des restaurants, et dont le tire-bouchon concluait la cage du grand escalier de l’habitacle. Ce « Piranèse » nous était propre et le concierge lui-même n’y avait accès qu’en tirant la sonnette. Il menait à trois chambres sans portes, en enfilade, et de plafond si basses qu’un huissier malappris y eût salué tout seul automatiquement, faute d’y pouvoir garder son chapeau sur la tête. Ces trois chambres n’étaient séparées du couloir de service, où s’ouvraient les logis des domestiques de l’immeuble, que par une cloison planchéiée au travers de laquelle sonnaient les moindres bruits de corridor. Pour la cuisine, elle était dans le « Piranèse ».
— Vous serez là comme des anges, nous avait dit Catulle, au centre de la ville, et le petit escalier est à lui seul une merveille !
— Nous en ferons notre salon ! m’écriai-je, emballé par son enthousiasme.
Et nous allâmes chercher notre mobilier à Neuilly. Il n’y fallut qu’un seul voyage et une voiture à bras, louée à un auverpin du quartier. Mais si le lit, démonté, passait dans le « Piranèse », l’armoire à glace n’y passait point. Il résistait, ou c’était elle ; mais l’un ou l’autre. Sous les traits toujours souriants d’Armand Silvestre, la Providence vint à notre aide.
— Démembrons l’armoire à glace ! Les trois cents Grecs de Léonidas n’allaient que un par un dans le défilé des Thermopyles !