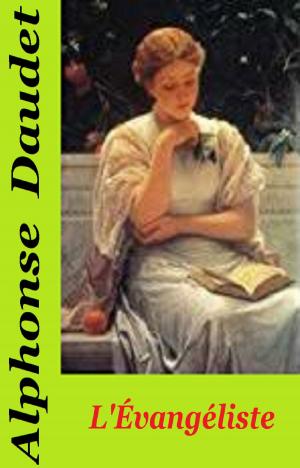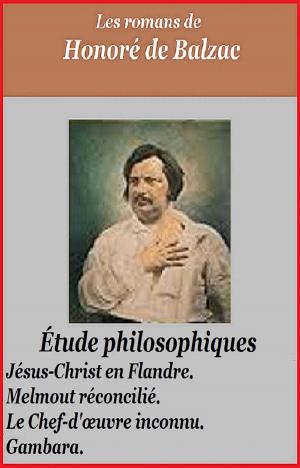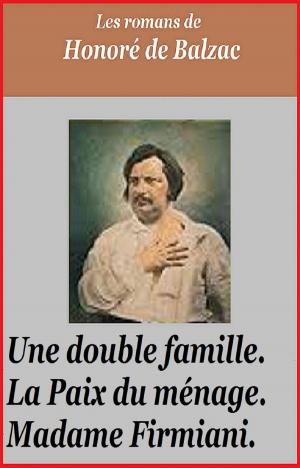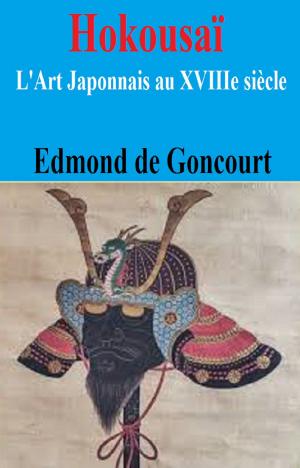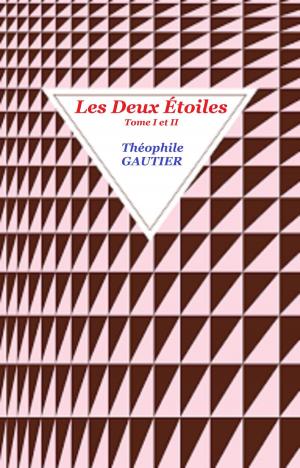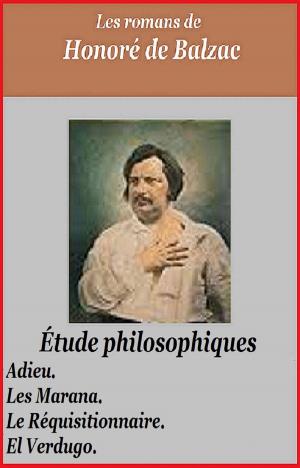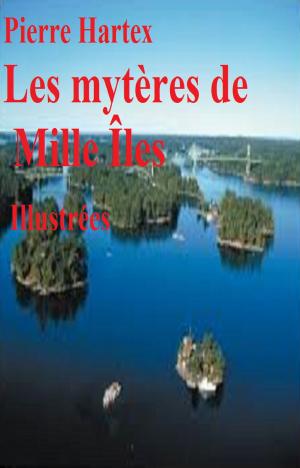| Author: | ROBERT LOUIS STEVENSON | ISBN: | 1230001232424 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | July 17, 2016 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | ROBERT LOUIS STEVENSON |
| ISBN: | 1230001232424 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | July 17, 2016 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Extrait :
C’était au mois de mai 1813 que j’avais eu le malheur de tomber aux mains des Anglais. Ma connaissance de la langue anglaise, — j’avais appris cette langue dès l’enfance et la parlais presque aussi aisément que le français, — m’avait valu d’être choisi par mon colonel pour certaine besogne des plus délicates. Un soldat doit toujours suivre sa consigne, quels qu’en soient les risques ; mais le risque de cette consigne-là consistait, pour moi, à être pendu comme espion, ce qui n’est jamais une perspective bien agréable : de telle sorte que je m’estimai heureux, quand je fus pris, de me voir simplement traité en prisonnier de guerre. On me transporta d’Espagne en Écosse, et je fus enfermé dans l’ancien château d’Édimbourg, qui — peut-être mon lecteur ne l’ignore-t-il pas ? — se dresse au milieu de cette ville, sur la pointe d’un rocher fort extraordinaire.
J’avais là pour compagnons plusieurs centaines de pauvres diables, tous simples soldats comme moi, et dont la plupart se trouvaient être des paysans ignorants et peu dégrossis. Ma connaissance de la langue anglaise, qui m’avait conduit à cette fâcheuse position, m’aidait maintenant beaucoup à la supporter. Elle me procurait mille petits avantages. Souvent on m’appelait pour servir d’interprète, soit que l’on eût des ordres à donner aux prisonniers, ou que ceux-ci eussent à faire quelque réclamation ; et ainsi j’entrais en rapports, parfois même assez familiers, avec les officiers anglais chargés de nous garder. Un jeune lieutenant avait daigné me choisir pour être son adversaire aux échecs ; j’étais particulièrement habile à ce jeu, et m’arrangeais si galamment pour perdre la partie que le petit lieutenant m’offrait, en récompense, d’excellents cigares. Le major du bataillon prenait de moi des leçons de français pendant son déjeuner, et parfois il poussait la condescendance jusqu’à me permettre de partager son repas. Ce major s’appelait Chevenix. Il était raide comme un tambour-major, et égoïste comme un Anglais, mais c’était un homme d’honneur. Sans pouvoir me résoudre à l’aimer, je me fiais à lui ; et, pour insignifiante que la chose puisse sembler, j’étais fort heureux de pouvoir, à l’occasion, plonger mes doigts dans sa tabatière d’écaille, où une fève achevait de donner un goût délicieux à du tabac d’Espagne de première qualité.
Nous étions, en somme, une troupe de prisonniers d’assez peu d’apparence. Tous les officiers français pris avec nous avaient obtenu leur liberté, moyennant leur parole d’honneur de ne pas sortir d’Édimbourg. Ils vivaient pour la plupart dans la ville basse, logés chez l’habitant ; et ils s’ennuyaient de leur mieux, supportant le plus philosophiquement qu’ils pouvaient les mauvaises nouvelles qui leur arrivaient, à présent presque sans arrêt, d’Espagne et d’Allemagne. Parmi les prisonniers du château, je me trouvais par hasard le seul gentilhomme. Bon nombre d’entre nous étaient des Italiens, d’un régiment qui avait subi de grosses pertes en Catalogne. Le reste étaient des laboureurs, des vignerons, des bûcherons, qui s’étaient vus soudainement, — et violemment, — promus au glorieux état de soldats de l’empereur.
Nous n’avions qu’un seul intérêt qui nous fût commun. Tous ceux d’entre nous qui possédaient quelque adresse de doigts employaient les heures de leur captivité à confectionner de petits jouets, — que nous appelions desarticles de Paris, — pour les vendre ensuite à nos visiteurs. Car notre prison était envahie tous les jours, dans l’après-midi, par une foule de gens de la ville et de la campagne, venus pour exulter de notre détresse, ou encore, — à juger les choses avec plus d’indulgence, — du triomphe accidentel de leur propre nation. Quelques-uns se comportaient parmi nous avec une certaine apparence de pitié ou de sympathie. D’autres, au contraire, étaient bien les personnages les plus impertinents du monde ; ils nous examinaient comme si nous avions été des babouins, cherchaient à nous convertir à leur religion, comme si nous avions été des sauvages, ou bien nous torturaient en nous criant les désastres des armes françaises. Mais, bons, méchants, ou indifférents, il y avait une compensation à l’ennui que nous causaient ces visiteurs car presque tous avaient l’habitude de nous acheter un échantillon de notre savoir-faire.
Cette coutume avait même fini par provoquer chez nous un certain esprit de compétition. Quelques-uns d’entre nous avaient la main habile, et parvenaient à mettre sur le marché des petits prodiges de dextérité, comme aussi de bon goût, car le génie du Français est toujours distingué. D’autres, à défaut de talent, avaient une apparence extérieure plus engageante : une jolie figure servait presque autant que de belles marchandises, au point de vue de notre commerce ; et un air de jeunesse, en particulier, avait de grandes chances de provoquer chez nos visiteurs un mouvement d’attention des plus lucratifs.
Extrait :
C’était au mois de mai 1813 que j’avais eu le malheur de tomber aux mains des Anglais. Ma connaissance de la langue anglaise, — j’avais appris cette langue dès l’enfance et la parlais presque aussi aisément que le français, — m’avait valu d’être choisi par mon colonel pour certaine besogne des plus délicates. Un soldat doit toujours suivre sa consigne, quels qu’en soient les risques ; mais le risque de cette consigne-là consistait, pour moi, à être pendu comme espion, ce qui n’est jamais une perspective bien agréable : de telle sorte que je m’estimai heureux, quand je fus pris, de me voir simplement traité en prisonnier de guerre. On me transporta d’Espagne en Écosse, et je fus enfermé dans l’ancien château d’Édimbourg, qui — peut-être mon lecteur ne l’ignore-t-il pas ? — se dresse au milieu de cette ville, sur la pointe d’un rocher fort extraordinaire.
J’avais là pour compagnons plusieurs centaines de pauvres diables, tous simples soldats comme moi, et dont la plupart se trouvaient être des paysans ignorants et peu dégrossis. Ma connaissance de la langue anglaise, qui m’avait conduit à cette fâcheuse position, m’aidait maintenant beaucoup à la supporter. Elle me procurait mille petits avantages. Souvent on m’appelait pour servir d’interprète, soit que l’on eût des ordres à donner aux prisonniers, ou que ceux-ci eussent à faire quelque réclamation ; et ainsi j’entrais en rapports, parfois même assez familiers, avec les officiers anglais chargés de nous garder. Un jeune lieutenant avait daigné me choisir pour être son adversaire aux échecs ; j’étais particulièrement habile à ce jeu, et m’arrangeais si galamment pour perdre la partie que le petit lieutenant m’offrait, en récompense, d’excellents cigares. Le major du bataillon prenait de moi des leçons de français pendant son déjeuner, et parfois il poussait la condescendance jusqu’à me permettre de partager son repas. Ce major s’appelait Chevenix. Il était raide comme un tambour-major, et égoïste comme un Anglais, mais c’était un homme d’honneur. Sans pouvoir me résoudre à l’aimer, je me fiais à lui ; et, pour insignifiante que la chose puisse sembler, j’étais fort heureux de pouvoir, à l’occasion, plonger mes doigts dans sa tabatière d’écaille, où une fève achevait de donner un goût délicieux à du tabac d’Espagne de première qualité.
Nous étions, en somme, une troupe de prisonniers d’assez peu d’apparence. Tous les officiers français pris avec nous avaient obtenu leur liberté, moyennant leur parole d’honneur de ne pas sortir d’Édimbourg. Ils vivaient pour la plupart dans la ville basse, logés chez l’habitant ; et ils s’ennuyaient de leur mieux, supportant le plus philosophiquement qu’ils pouvaient les mauvaises nouvelles qui leur arrivaient, à présent presque sans arrêt, d’Espagne et d’Allemagne. Parmi les prisonniers du château, je me trouvais par hasard le seul gentilhomme. Bon nombre d’entre nous étaient des Italiens, d’un régiment qui avait subi de grosses pertes en Catalogne. Le reste étaient des laboureurs, des vignerons, des bûcherons, qui s’étaient vus soudainement, — et violemment, — promus au glorieux état de soldats de l’empereur.
Nous n’avions qu’un seul intérêt qui nous fût commun. Tous ceux d’entre nous qui possédaient quelque adresse de doigts employaient les heures de leur captivité à confectionner de petits jouets, — que nous appelions desarticles de Paris, — pour les vendre ensuite à nos visiteurs. Car notre prison était envahie tous les jours, dans l’après-midi, par une foule de gens de la ville et de la campagne, venus pour exulter de notre détresse, ou encore, — à juger les choses avec plus d’indulgence, — du triomphe accidentel de leur propre nation. Quelques-uns se comportaient parmi nous avec une certaine apparence de pitié ou de sympathie. D’autres, au contraire, étaient bien les personnages les plus impertinents du monde ; ils nous examinaient comme si nous avions été des babouins, cherchaient à nous convertir à leur religion, comme si nous avions été des sauvages, ou bien nous torturaient en nous criant les désastres des armes françaises. Mais, bons, méchants, ou indifférents, il y avait une compensation à l’ennui que nous causaient ces visiteurs car presque tous avaient l’habitude de nous acheter un échantillon de notre savoir-faire.
Cette coutume avait même fini par provoquer chez nous un certain esprit de compétition. Quelques-uns d’entre nous avaient la main habile, et parvenaient à mettre sur le marché des petits prodiges de dextérité, comme aussi de bon goût, car le génie du Français est toujours distingué. D’autres, à défaut de talent, avaient une apparence extérieure plus engageante : une jolie figure servait presque autant que de belles marchandises, au point de vue de notre commerce ; et un air de jeunesse, en particulier, avait de grandes chances de provoquer chez nos visiteurs un mouvement d’attention des plus lucratifs.