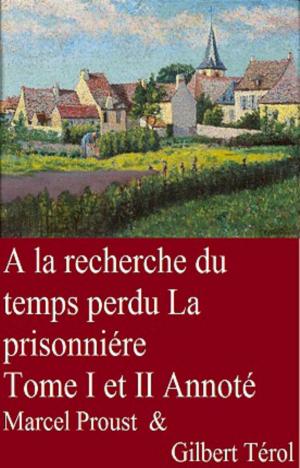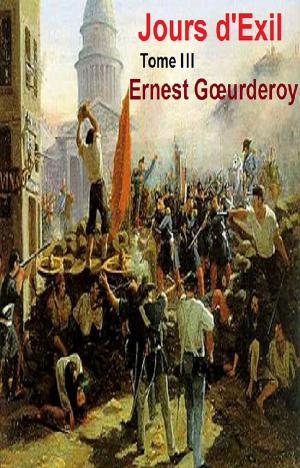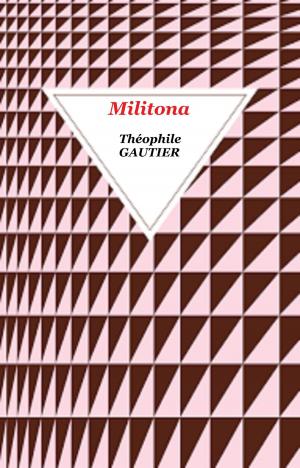| Author: | Paul Bourget | ISBN: | 1230000213557 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 28, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Paul Bourget |
| ISBN: | 1230000213557 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 28, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
S’il fallait une preuve nouvelle aux vieilles théories sur là multiplicité foncière de notre personne, on la trouverait dans cette loi, habituel objet d’indignation pour les moralistes, qui veut que le chagrin des êtres les plus aimés ne puisse, à de certaines minutes, nous empêcher d’être heureux. Il semble que nos sentiments soutiennent dans notre cœur, et les uns contre les autres, une sorte de lutte pour la vie. L’intensité d’existence de l’un d’entre eux, même momentanée, ne s’obtient guère que par l’exténuation des autres. Il est certain qu’Hubert Liauran chérissait éperdument ses deux mères, — comme il appelait toujours les deux femmes qui l’avaient élevé. Il est certain qu’il avait deviné qu’elles tenaient ensemble, depuis bien des jours, des conversations analogues à celle du soir où il avait emprunté à son parrain les trois mille francs dont il avait besoin pour régler ses dettes et suffire à son voyage. Et cependant, lorsqu’il fut monté, au surlendemain de ce soir, dans le train qui l’emportait vers Boulogne, il lui fut impossible de ne pas se sentir l’âme comme noyée dans une félicité divine. Il ne se demandait pas si le comte Scilly parlerait ou non de sa démarche ; il écartait cette appréhension, comme il éloignait le souvenir des yeux de Mme Liauran à l’instant de son départ, comme il étouffait les scrupules que pouvait lui donner sa piété intransigeante. S’il n’avait pas menti absolument à sa mère en lui disant qu’il allait rejoindre à Londres son ami Emmanuel Deroy, il avait pourtant trompé cette mère jalouse en lui cachant qu’à Folkestone il retrouverait Mme de Sauve. Or, Mme de Sauve n’était pas libre. Mme de Sauve était mariée, et pour un jeune homme élevé comme l’avait été le pieux Hubert, aimer une femme mariée constituait une faute inexpiable. Hubert devait se croire et se croyait en état de péché mortel. Son catholicisme, qui n’était pas une religion de mode et d’attitude, ne lui laissait aucun doute sur ce point. Mais, religion, famille, devoir de franchise, crainte de l’avenir, ces nobles fantômes de la conscience ne lui apparaissaient qu’à l’état de fantômes, vaines images sans puissance et qui s’évanouissaient devant l’évocation vivante de cette femme qui, depuis cinq mois, était entrée dans son cœur pour tout y renouveler ; — de la femme qu’il aimait et dont il se savait aimé. En répondant à son parrain qu’il n’avait pas de maîtresse, Hubert avait dit vrai, en ceci qu’il n’était pas l’amant de Mme de Sauve au sens de possession physique et entière où l’on prend aujourd’hui ce terme. Elle ne lui avait jamais appartenu, et c’était la première fois qu’il allait se trouver réellement seul avec elle dans cette solitude d’un pays étranger, — rêve secret de chaque être qui aime. Tandis que le train courait à toute vapeur parmi les plaines tour à tour ondulées de collines, coupées de cours d’eau, hérissées d’arbres dénudés, le jeune homme égrenait longuement le secret rosaire de ses souvenirs. Le charme des heures passées lui était rendu plus cher par l’attente d’il ne savait quel immense bonheur. Quoique le fils de Mme Liauran eût vingt-deux ans, la rigueur de son éducation l’avait maintenu dans cet état de pureté si rare parmi les jeunes gens de Paris, lesquels ont pour la plupart épuisé le plaisir avant d’avoir même soupçonné l’amour. Mais ce dont cet enfant ne se rendait pas compte, c’est que, précisément, cette pureté avait agi, mieux que les roueries les plus savantes, sur l’imagination romanesque de la femme dont le profil passait et repassait devant ses regards au gré des mouvements du wagon, se détachant tour à tour sur les bois, sur les coteaux et sur les dunes. Combien d’images emporte ainsi un train qui fuit, et, avec elles, combien de destinées, précipitées vers le bonheur ou vers le malheur, dans le lointain et l’inconnu !… C’est au commencement du mois d’octobre de l’année précédente qu’Hubert avait vu Mme de Sauve pour la première fois. À cause de la santé de Mme Liauran, que le moindre voyage eût menacée, les deux femmes ne quittaient jamais Paris ; mais le jeune homme allait parfois, durant l’été ou l’automne, passer une moitié de semaine dans quelque château. Il revenait d’une de ces visites, en compagnie de son cousin George. À une station située sur cette même ligne du Nord qu’il suivait maintenant, il avait, en montant dans un wagon, rencontré la jeune femme avec son mari. Les de Sauve étaient en relations avec George, et c’est ainsi qu’Hubert avait été présenté. M. de Sauve était un homme d’environ quarante-sept ans, très grand et fort, avec un visage déjà trop rouge et les traces, à travers sa vigueur, d’une usure qui s’expliquait, rien qu’à écouter sa conversation, par sa manière d’entendre la vie. Exister, pour lui, c’était se prodiguer, et il réalisait ce programme dans tous les sens. Chef de cabinet d’un ministre en 1869, jeté après la guerre dans la campagne de propagande bonapartiste, député depuis lors et toujours réélu, mais député agissant et qui pratiquait ses électeurs, il s’était en même temps de plus en plus lancé dans ce monde de luxe et de plaisir qui a son quartier général entre le parc Monceau et les Champs-Elysées.
Il avait un salon, donnait des dîners, s’occupait de sport, et il trouvait encore le loisir de s’intéresser avec compétence et succès à des entreprises financières. Ajoutez à cela qu’avant son mariage il avait beaucoup fréquenté le corps de ballet, les coulisses des petits théâtres et les cabinets particuliers. La nature fabrique ainsi certains tempéraments, comme des machines à grosses dépenses, et, par suite, à grosses recettes. Tout, dans André de Sauve, révélait le goût de ce qui est ample et puissant, depuis la construction de son grand corps jusqu’à sa manière de se vêtir et jusqu’au geste par lequel il prenait un long et noir cigare dans son étui, pour le fumer. Hubert se souvenait d’avoir éprouvé pour cet homme aux mains et aux oreilles velues, aux larges pieds, à l’encolure de dragon, la sorte de répulsion physique dont nous souffrons à la rencontre d’une physiologie exactement contraire à la nôtre. N’y a-t-il pas des respirations, des circulations du sang, des jeux de muscles que nous sentons hostiles, probablement grâce à cet indéfinissable instinct de la vie qui pousse deux animaux d’espèce différente à se déchirer aussitôt qu’ils s’affrontent ?
S’il fallait une preuve nouvelle aux vieilles théories sur là multiplicité foncière de notre personne, on la trouverait dans cette loi, habituel objet d’indignation pour les moralistes, qui veut que le chagrin des êtres les plus aimés ne puisse, à de certaines minutes, nous empêcher d’être heureux. Il semble que nos sentiments soutiennent dans notre cœur, et les uns contre les autres, une sorte de lutte pour la vie. L’intensité d’existence de l’un d’entre eux, même momentanée, ne s’obtient guère que par l’exténuation des autres. Il est certain qu’Hubert Liauran chérissait éperdument ses deux mères, — comme il appelait toujours les deux femmes qui l’avaient élevé. Il est certain qu’il avait deviné qu’elles tenaient ensemble, depuis bien des jours, des conversations analogues à celle du soir où il avait emprunté à son parrain les trois mille francs dont il avait besoin pour régler ses dettes et suffire à son voyage. Et cependant, lorsqu’il fut monté, au surlendemain de ce soir, dans le train qui l’emportait vers Boulogne, il lui fut impossible de ne pas se sentir l’âme comme noyée dans une félicité divine. Il ne se demandait pas si le comte Scilly parlerait ou non de sa démarche ; il écartait cette appréhension, comme il éloignait le souvenir des yeux de Mme Liauran à l’instant de son départ, comme il étouffait les scrupules que pouvait lui donner sa piété intransigeante. S’il n’avait pas menti absolument à sa mère en lui disant qu’il allait rejoindre à Londres son ami Emmanuel Deroy, il avait pourtant trompé cette mère jalouse en lui cachant qu’à Folkestone il retrouverait Mme de Sauve. Or, Mme de Sauve n’était pas libre. Mme de Sauve était mariée, et pour un jeune homme élevé comme l’avait été le pieux Hubert, aimer une femme mariée constituait une faute inexpiable. Hubert devait se croire et se croyait en état de péché mortel. Son catholicisme, qui n’était pas une religion de mode et d’attitude, ne lui laissait aucun doute sur ce point. Mais, religion, famille, devoir de franchise, crainte de l’avenir, ces nobles fantômes de la conscience ne lui apparaissaient qu’à l’état de fantômes, vaines images sans puissance et qui s’évanouissaient devant l’évocation vivante de cette femme qui, depuis cinq mois, était entrée dans son cœur pour tout y renouveler ; — de la femme qu’il aimait et dont il se savait aimé. En répondant à son parrain qu’il n’avait pas de maîtresse, Hubert avait dit vrai, en ceci qu’il n’était pas l’amant de Mme de Sauve au sens de possession physique et entière où l’on prend aujourd’hui ce terme. Elle ne lui avait jamais appartenu, et c’était la première fois qu’il allait se trouver réellement seul avec elle dans cette solitude d’un pays étranger, — rêve secret de chaque être qui aime. Tandis que le train courait à toute vapeur parmi les plaines tour à tour ondulées de collines, coupées de cours d’eau, hérissées d’arbres dénudés, le jeune homme égrenait longuement le secret rosaire de ses souvenirs. Le charme des heures passées lui était rendu plus cher par l’attente d’il ne savait quel immense bonheur. Quoique le fils de Mme Liauran eût vingt-deux ans, la rigueur de son éducation l’avait maintenu dans cet état de pureté si rare parmi les jeunes gens de Paris, lesquels ont pour la plupart épuisé le plaisir avant d’avoir même soupçonné l’amour. Mais ce dont cet enfant ne se rendait pas compte, c’est que, précisément, cette pureté avait agi, mieux que les roueries les plus savantes, sur l’imagination romanesque de la femme dont le profil passait et repassait devant ses regards au gré des mouvements du wagon, se détachant tour à tour sur les bois, sur les coteaux et sur les dunes. Combien d’images emporte ainsi un train qui fuit, et, avec elles, combien de destinées, précipitées vers le bonheur ou vers le malheur, dans le lointain et l’inconnu !… C’est au commencement du mois d’octobre de l’année précédente qu’Hubert avait vu Mme de Sauve pour la première fois. À cause de la santé de Mme Liauran, que le moindre voyage eût menacée, les deux femmes ne quittaient jamais Paris ; mais le jeune homme allait parfois, durant l’été ou l’automne, passer une moitié de semaine dans quelque château. Il revenait d’une de ces visites, en compagnie de son cousin George. À une station située sur cette même ligne du Nord qu’il suivait maintenant, il avait, en montant dans un wagon, rencontré la jeune femme avec son mari. Les de Sauve étaient en relations avec George, et c’est ainsi qu’Hubert avait été présenté. M. de Sauve était un homme d’environ quarante-sept ans, très grand et fort, avec un visage déjà trop rouge et les traces, à travers sa vigueur, d’une usure qui s’expliquait, rien qu’à écouter sa conversation, par sa manière d’entendre la vie. Exister, pour lui, c’était se prodiguer, et il réalisait ce programme dans tous les sens. Chef de cabinet d’un ministre en 1869, jeté après la guerre dans la campagne de propagande bonapartiste, député depuis lors et toujours réélu, mais député agissant et qui pratiquait ses électeurs, il s’était en même temps de plus en plus lancé dans ce monde de luxe et de plaisir qui a son quartier général entre le parc Monceau et les Champs-Elysées.
Il avait un salon, donnait des dîners, s’occupait de sport, et il trouvait encore le loisir de s’intéresser avec compétence et succès à des entreprises financières. Ajoutez à cela qu’avant son mariage il avait beaucoup fréquenté le corps de ballet, les coulisses des petits théâtres et les cabinets particuliers. La nature fabrique ainsi certains tempéraments, comme des machines à grosses dépenses, et, par suite, à grosses recettes. Tout, dans André de Sauve, révélait le goût de ce qui est ample et puissant, depuis la construction de son grand corps jusqu’à sa manière de se vêtir et jusqu’au geste par lequel il prenait un long et noir cigare dans son étui, pour le fumer. Hubert se souvenait d’avoir éprouvé pour cet homme aux mains et aux oreilles velues, aux larges pieds, à l’encolure de dragon, la sorte de répulsion physique dont nous souffrons à la rencontre d’une physiologie exactement contraire à la nôtre. N’y a-t-il pas des respirations, des circulations du sang, des jeux de muscles que nous sentons hostiles, probablement grâce à cet indéfinissable instinct de la vie qui pousse deux animaux d’espèce différente à se déchirer aussitôt qu’ils s’affrontent ?