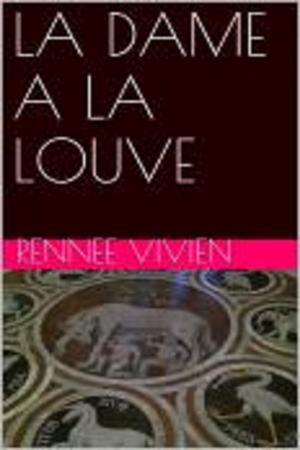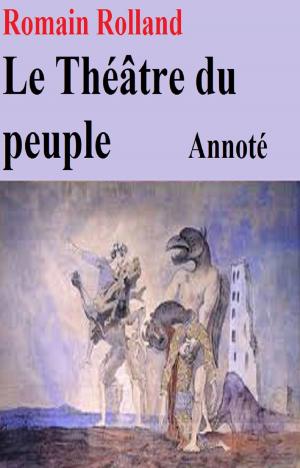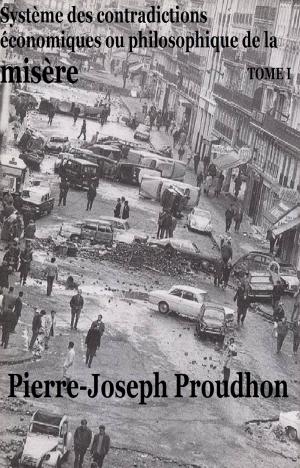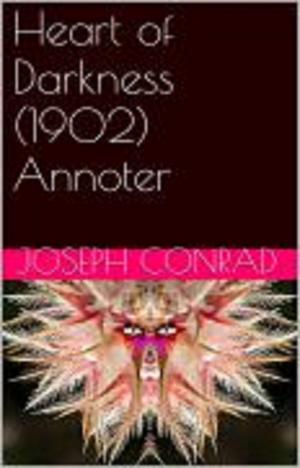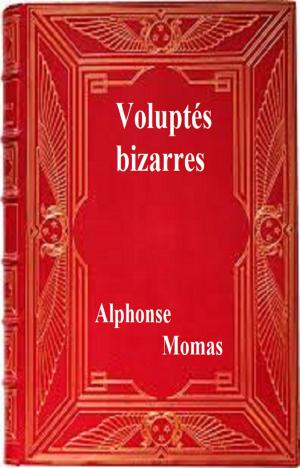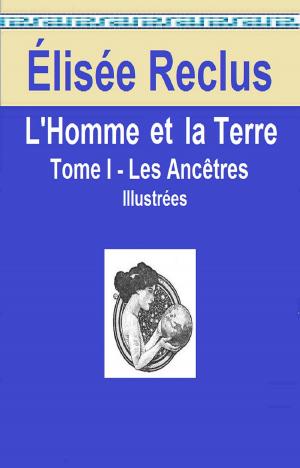| Author: | ALBERT ADÈS, ALBERT JOSIPOVICI | ISBN: | 1230000210832 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 19, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | ALBERT ADÈS, ALBERT JOSIPOVICI |
| ISBN: | 1230000210832 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 19, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Quand Cheik-el-Zaki sortit de l’Université, quelques hommes se précipitèrent à sa rencontre. C’étaient des boutiquiers du voisinage auxquels, après sa conférence quotidienne, le maître éminent enseignait les éléments de la lecture et de la calligraphie. Ce soir-là, il passa devant eux le visage morne et, d’un geste, les écarta. Ils s’étonnèrent de cette brusquerie, car le cheik avait toujours accueilli avec une douceur charitable leur ignorance et leur pauvreté.
La cour d’El-Azhar, quadrilatère immense bordé de trois cent quatre-vingts colonnes, formait avec le ciel, percé de minarets, un monde splendide et isolé. Douze mille étudiants venus du Maghreb, du Soudan, du Yémen, du Turkestan de l’Inde, de la Perse, s’abreuvaient à cette fontaine de sagesse, la plus pure de l’Islam. Ils étaient tous maigres. Dans leurs yeux largement ouverts luisait une étincelle de fanatisme. Issus de races bruyantes et sensuelles, ils concentraient toute leur vitalité dans l’étude du livre où est recueilli le Verbe de Dieu. Leur cou très long était marqué de veines saillantes, leurs épaules étaient étroites et anguleuses, leurs doigts effilés. Ils portaient autour de leur calotte de feutre une large bande d’étoffe repliée qui enserrait leurs oreilles. Leur physionomie était hautaine, fermée, farouche. Naïfs dans leur foi, ils méprisaient ostensiblement les jouissances matérielles. On en voyait des centaines qui, parvenus à la vieillesse, s’instruisaient encore. N’ayant pu obtenir le titre de cheik, ils finissaient leurs jours sur la même natte où ils s’étaient assis enfants.
Les maîtres différaient de leurs disciples. On eût dit que sur les cimes de la science ils jouissaient d’un spectacle réconfortant. À les voir robustes, affables, indulgents, on se demandait comment la pensée qui entretenait l’équilibre de leurs facultés morales et la santé de leur organisme pouvait consumer les corps malingres qui la recevaient d’eux avec enthousiasme.
Comme il était sous le portique, Cheik-el-Zaki fut abordé par un étudiant qui, s’inclinant avec aisance, tenta de lui baiser la main.
— Non… Non… dit le savant.
Il esquissa un geste de protestation et reprit :
— Que ta soirée soit bénie, Waddah-Alyçum.
Il scruta le visage du jeune homme aux lignes pures et serrées. La conscience presque féminine qu’Alyçum avait de sa beauté lui donnait un constant souci de séduire et mettait de la joliesse sur ses traits un peu durs.
— Mon père, voulez-vous m’éclairer ? dit-il… J’ai besoin de vos conseils.
— T’éclairer ? je te croyais mort d’ennui… Ma conférence a duré deux heures !
Sa physionomie s’assombrit tout à coup et il ajouta :
— Je suis un mauvais maître.
Ces mots prononcés avec amertume surprirent le jeune homme. Mais déjà le cheik l’avait pris familièrement par le bras :
— Viens, dit-il, accompagne-moi.
Alyçum ramena sur son visage une gaze blanche fixée à son turban.
— Toujours la même folie ! plaisanta Cheik-el-Zaki.
Alyçum ainsi que Mokawa-Kendi et Akr-Zeid-Taï, ses amis, ne se mêlait jamais à la foule la face découverte. On les voyait le plus souvent ensemble. Leurs silhouettes minces et droites se ressemblaient et, dans toute l’Égypte, la perfection de leur beauté avait illustré leur nom. Il répondit avec emphase que sur une main vulgaire l’émeraude semble fausse et que dans une ambiance médiocre la beauté perd de son éclat.
— Prends bien garde, dit El-Zaki, le vent soulève ton voile… le regard d’un passant pourrait t’enlaidir.
— Vous vous moquez de moi, mon père ; voulez-vous que je me découvre ?
— Par Allah ! n’en fais rien, le mauvais œil te guette…
Les gens s’écartaient avec déférence au passage d’El-Zaki. Parfois ils se prosternaient à son approche ou, d’un geste furtif, baisaient la manche large de son caftan. Dans leurs petites boutiques sans devanture, rehaussées de quelques marches, des libraires, des orfèvres, des armuriers, des merciers accroupis sur des nattes et un chapelet aux doigts, se livraient à des calculs en marmonnant des hadiths.
Cheik-el-Zaki, doté d’une large fortune et qui était parvenu à l’une des plus hautes dignités universitaires, avait le souci de ses gestes, afin que nul ne se permît la moindre privauté à son égard. Dédaigneux et bienveillant, il se mêlait à la foule avec la certitude qu’elle ne lui marchanderait pas les marques de respect.
Quand Cheik-el-Zaki sortit de l’Université, quelques hommes se précipitèrent à sa rencontre. C’étaient des boutiquiers du voisinage auxquels, après sa conférence quotidienne, le maître éminent enseignait les éléments de la lecture et de la calligraphie. Ce soir-là, il passa devant eux le visage morne et, d’un geste, les écarta. Ils s’étonnèrent de cette brusquerie, car le cheik avait toujours accueilli avec une douceur charitable leur ignorance et leur pauvreté.
La cour d’El-Azhar, quadrilatère immense bordé de trois cent quatre-vingts colonnes, formait avec le ciel, percé de minarets, un monde splendide et isolé. Douze mille étudiants venus du Maghreb, du Soudan, du Yémen, du Turkestan de l’Inde, de la Perse, s’abreuvaient à cette fontaine de sagesse, la plus pure de l’Islam. Ils étaient tous maigres. Dans leurs yeux largement ouverts luisait une étincelle de fanatisme. Issus de races bruyantes et sensuelles, ils concentraient toute leur vitalité dans l’étude du livre où est recueilli le Verbe de Dieu. Leur cou très long était marqué de veines saillantes, leurs épaules étaient étroites et anguleuses, leurs doigts effilés. Ils portaient autour de leur calotte de feutre une large bande d’étoffe repliée qui enserrait leurs oreilles. Leur physionomie était hautaine, fermée, farouche. Naïfs dans leur foi, ils méprisaient ostensiblement les jouissances matérielles. On en voyait des centaines qui, parvenus à la vieillesse, s’instruisaient encore. N’ayant pu obtenir le titre de cheik, ils finissaient leurs jours sur la même natte où ils s’étaient assis enfants.
Les maîtres différaient de leurs disciples. On eût dit que sur les cimes de la science ils jouissaient d’un spectacle réconfortant. À les voir robustes, affables, indulgents, on se demandait comment la pensée qui entretenait l’équilibre de leurs facultés morales et la santé de leur organisme pouvait consumer les corps malingres qui la recevaient d’eux avec enthousiasme.
Comme il était sous le portique, Cheik-el-Zaki fut abordé par un étudiant qui, s’inclinant avec aisance, tenta de lui baiser la main.
— Non… Non… dit le savant.
Il esquissa un geste de protestation et reprit :
— Que ta soirée soit bénie, Waddah-Alyçum.
Il scruta le visage du jeune homme aux lignes pures et serrées. La conscience presque féminine qu’Alyçum avait de sa beauté lui donnait un constant souci de séduire et mettait de la joliesse sur ses traits un peu durs.
— Mon père, voulez-vous m’éclairer ? dit-il… J’ai besoin de vos conseils.
— T’éclairer ? je te croyais mort d’ennui… Ma conférence a duré deux heures !
Sa physionomie s’assombrit tout à coup et il ajouta :
— Je suis un mauvais maître.
Ces mots prononcés avec amertume surprirent le jeune homme. Mais déjà le cheik l’avait pris familièrement par le bras :
— Viens, dit-il, accompagne-moi.
Alyçum ramena sur son visage une gaze blanche fixée à son turban.
— Toujours la même folie ! plaisanta Cheik-el-Zaki.
Alyçum ainsi que Mokawa-Kendi et Akr-Zeid-Taï, ses amis, ne se mêlait jamais à la foule la face découverte. On les voyait le plus souvent ensemble. Leurs silhouettes minces et droites se ressemblaient et, dans toute l’Égypte, la perfection de leur beauté avait illustré leur nom. Il répondit avec emphase que sur une main vulgaire l’émeraude semble fausse et que dans une ambiance médiocre la beauté perd de son éclat.
— Prends bien garde, dit El-Zaki, le vent soulève ton voile… le regard d’un passant pourrait t’enlaidir.
— Vous vous moquez de moi, mon père ; voulez-vous que je me découvre ?
— Par Allah ! n’en fais rien, le mauvais œil te guette…
Les gens s’écartaient avec déférence au passage d’El-Zaki. Parfois ils se prosternaient à son approche ou, d’un geste furtif, baisaient la manche large de son caftan. Dans leurs petites boutiques sans devanture, rehaussées de quelques marches, des libraires, des orfèvres, des armuriers, des merciers accroupis sur des nattes et un chapelet aux doigts, se livraient à des calculs en marmonnant des hadiths.
Cheik-el-Zaki, doté d’une large fortune et qui était parvenu à l’une des plus hautes dignités universitaires, avait le souci de ses gestes, afin que nul ne se permît la moindre privauté à son égard. Dédaigneux et bienveillant, il se mêlait à la foule avec la certitude qu’elle ne lui marchanderait pas les marques de respect.