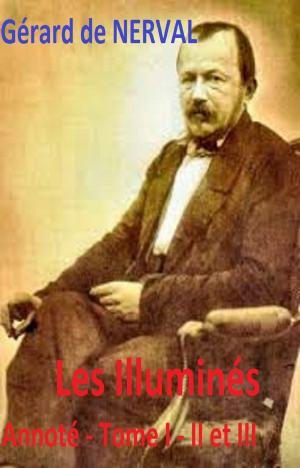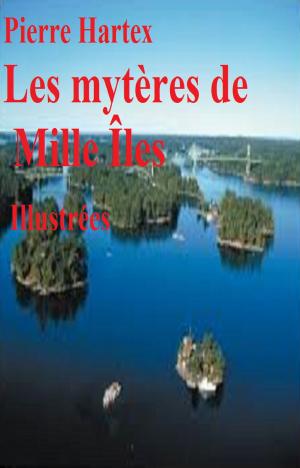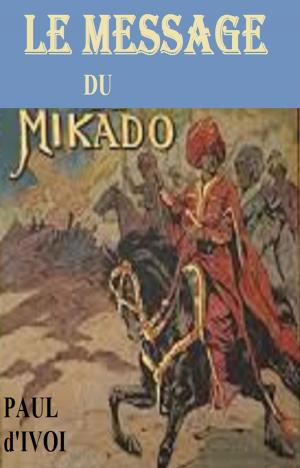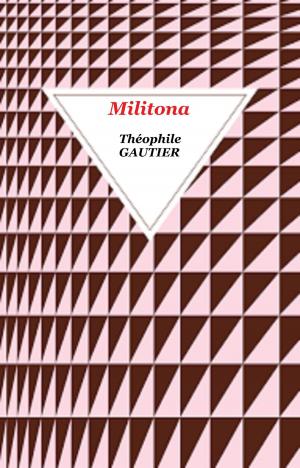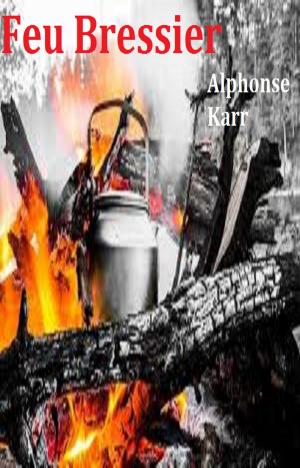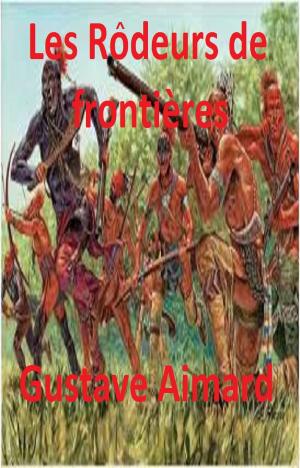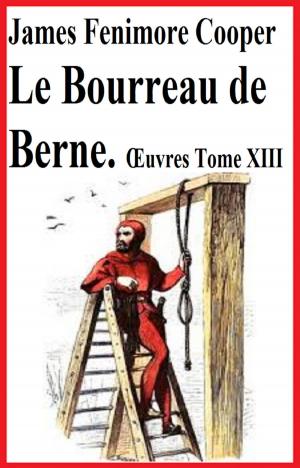| Author: | CHARLES NODIER | ISBN: | 1230000211108 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 20, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | CHARLES NODIER |
| ISBN: | 1230000211108 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 20, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Je m’appelle Adolphe de S…, je suis né à Strasbourg, le 19 janvier 1777, d’une famille noble dont j’étais le dernier rejeton. J’ai perdu mon père dans l’émigration. Ma mère a péri dans une maison de détention pour les suspects ; je n’ai ni frères, ni sœurs, ni parents de mon nom. J’ai dix-sept ans et demi depuis quelques jours, et rien n’annonce que cette courte existence puisse se prolonger. J’en dirai même la raison plus tard, quoique ma position n’intéresse plus personne. Aussi, ce n’est pas pour le monde que j’écris ces lignes inutiles ; c’est pour moi, pour moi seul ; c’est pour occuper, pour perdre de tristes et désespérants loisirs qui seront heureusement bien courts. C’est pour ouvrir une voie plus facile aux sentiments qui m’oppressent, pour soulager mon cœur si le souvenir est un soulagement, ou pour achever de le briser.
J’avais suivi mon père à quatorze ans ; je venais de le perdre à seize. J’étais rentré à Strasbourg, rapportant pour tout bien son dernier adieu, ses derniers conseils, l’exemple de son dévouement, de son courage, de ses vertus privées, et je ne sais quelle émulation de malheur qui relève l’âme. Je cherchais ma mère ; on ignorait jusqu’à sa fosse. Nos biens n’étaient plus à nous. Nos parents étaient errants ou morts. Nos anciens amis auraient craint de me reconnaître, et probablement il y en avait parmi eux qui ne m’auraient plus aimé ; j’étais si à plaindre ! J’avais eu pour professeur de grec un moine qui s’appelait le père Schneider, et pour maître de musique un virtuose qui s’appelait M. Edelman. L’un et l’autre avaient embrassé avec violence le parti de la révolution ; je m’informai d’eux cependant, parce que je les avais vus s’honorer de l’amitié de mon père, et que leur pitié, à eux, était ma dernière ressource. Le premier venait d’être lié aux poteaux de l’échafaud dans un mouvement populaire ; je passai sur la place d’Armes ; je le reconnus pâle, défiguré, sanglant. La clameur publique l’accusait des forfaits les plus odieux ; mais il avait été mon maître, il m’avait peut-être aimé ; j’aurais volé à lui, si je n’avais craint que ma tendresse ne le chargeât d’un crime de plus. Je pleurai amèrement en cachant mon visage. M. Edelman avait été arrêté le même jour. Quelques mois après, m’a-t-on dit, ils sont tombés à Paris, sous cette faux terrible de la révolution qui n’épargne pas ses enfants.
Mon dernier assignat avait été échangé contre un peu de pain. Il faisait très froid, la journée s’avançait, et je ne savais où me retirer. Je me souvins que, dans une petite ville assez voisine, j’avais passé quelques jours de mon enfance chez la jolie hôtesse de… Ma reconnaissance, hélas ! n’ose pas la nommer. Comme elle était connue par son attachement à ce qu’on appelait les aristocrates, c’était dans sa maison que nous avions couchée, mon père et moi, la nuit qui précéda notre émigration. J’employai à ce voyage tout ce qui me restait de forces. J’arrivai à la nuit obscure ; je gagnai avec précipitation le cabinet de madame T…, et je me jetai, ou plutôt je tombai à ses pieds, car je ne pouvais plus me soutenir.
— Au nom de la charité, lui dis-je, un peu de vin pour se remettre, un peu de paille pour se reposer, à votre pauvre petit Adolphe ! Je meurs s’il faut que je passe encore cette nuit dans la neige !
Elle m’embrassa et pleura ; et comme ses larmes l’embellissaient ! Ensuite, elle me recommanda d’être prudent, et me conduisit dans une chambre écartée où il y avait trois lits. J’étais seulement prévenu que je n’avais rien à redouter de mes voisins. C’étaient des compagnons de malheur, mais je ne les connus pas ce jour-là. J’avais à peine achevé mon léger repas que tous mes sens furent liés par le sommeil. Quand je rouvris les yeux, il faisait jour.
Mes camarades m’embrassèrent en frères ; le nom de mon père ne leur était pas étranger. Nos sentiments étaient les mêmes ; notre fortune, notre destinée étaient communes ; ils m’offraient d’ailleurs quelque chose de plus que des consolations ; ils parlaient de grands dangers à courir, de quelque gloire à mériter. Ils voulaient changer mon sort, et j’étais jaloux déjà de partager le leur, quel qu’il fût.
L’amitié doit être un sentiment délicieux à toutes les époques et dans toutes les conditions de la vie ; mais, entre de jeunes âmes froissées par de nobles malheurs, c’est presque une religion.
L’un de ces messieurs avait dix-huit à vingt ans. C’était un jeune homme d’une figure affable mais sérieuse, plein de calme et de résolution, d’énergie et de présence d’esprit. Il s’appelait Forestier, et je crois qu’il était fils d’un cordonnier de Saumur ou de Cholet, je ne sais pas lequel. L’autre, qui avait pour lui la plus grande déférence, était de deux ou trois ans plus jeunes et se nommait le chevalier de Mondyon. Quoiqu’il fût tout au plus de mon âge, il était beaucoup plus développé que moi. Ma petite taille, mes yeux bleus, la couleur un peu ardente de mes cheveux bouclés, la fraîcheur d’un teint animé que je tiens de ma mère et qui caractérise nos Alsaciennes, me donnait, à mon grand regret, quelque chose de féminin et de timide qui m’avait souvent exposé, sur mon passage, aux soupçons et aux railleries des voyageurs mal élevés.
— En vérité, dit Mondyon avec un ton de gaieté expansive qui ne l’abandonnait jamais, nous aurons peine à persuader au général que ce nouveau camarade ne soit pas une jeune fille déguisée.
— Je le détromperai de cette erreur, lui répondis-je, sur le premier champ de bataille où il y aura du sang à répandre pour le service du roi.
Forestier sourit et me serra vivement la main ; Mondyon, qui craignait de m’avoir mortifié, me sauta au cou.
Je m’appelle Adolphe de S…, je suis né à Strasbourg, le 19 janvier 1777, d’une famille noble dont j’étais le dernier rejeton. J’ai perdu mon père dans l’émigration. Ma mère a péri dans une maison de détention pour les suspects ; je n’ai ni frères, ni sœurs, ni parents de mon nom. J’ai dix-sept ans et demi depuis quelques jours, et rien n’annonce que cette courte existence puisse se prolonger. J’en dirai même la raison plus tard, quoique ma position n’intéresse plus personne. Aussi, ce n’est pas pour le monde que j’écris ces lignes inutiles ; c’est pour moi, pour moi seul ; c’est pour occuper, pour perdre de tristes et désespérants loisirs qui seront heureusement bien courts. C’est pour ouvrir une voie plus facile aux sentiments qui m’oppressent, pour soulager mon cœur si le souvenir est un soulagement, ou pour achever de le briser.
J’avais suivi mon père à quatorze ans ; je venais de le perdre à seize. J’étais rentré à Strasbourg, rapportant pour tout bien son dernier adieu, ses derniers conseils, l’exemple de son dévouement, de son courage, de ses vertus privées, et je ne sais quelle émulation de malheur qui relève l’âme. Je cherchais ma mère ; on ignorait jusqu’à sa fosse. Nos biens n’étaient plus à nous. Nos parents étaient errants ou morts. Nos anciens amis auraient craint de me reconnaître, et probablement il y en avait parmi eux qui ne m’auraient plus aimé ; j’étais si à plaindre ! J’avais eu pour professeur de grec un moine qui s’appelait le père Schneider, et pour maître de musique un virtuose qui s’appelait M. Edelman. L’un et l’autre avaient embrassé avec violence le parti de la révolution ; je m’informai d’eux cependant, parce que je les avais vus s’honorer de l’amitié de mon père, et que leur pitié, à eux, était ma dernière ressource. Le premier venait d’être lié aux poteaux de l’échafaud dans un mouvement populaire ; je passai sur la place d’Armes ; je le reconnus pâle, défiguré, sanglant. La clameur publique l’accusait des forfaits les plus odieux ; mais il avait été mon maître, il m’avait peut-être aimé ; j’aurais volé à lui, si je n’avais craint que ma tendresse ne le chargeât d’un crime de plus. Je pleurai amèrement en cachant mon visage. M. Edelman avait été arrêté le même jour. Quelques mois après, m’a-t-on dit, ils sont tombés à Paris, sous cette faux terrible de la révolution qui n’épargne pas ses enfants.
Mon dernier assignat avait été échangé contre un peu de pain. Il faisait très froid, la journée s’avançait, et je ne savais où me retirer. Je me souvins que, dans une petite ville assez voisine, j’avais passé quelques jours de mon enfance chez la jolie hôtesse de… Ma reconnaissance, hélas ! n’ose pas la nommer. Comme elle était connue par son attachement à ce qu’on appelait les aristocrates, c’était dans sa maison que nous avions couchée, mon père et moi, la nuit qui précéda notre émigration. J’employai à ce voyage tout ce qui me restait de forces. J’arrivai à la nuit obscure ; je gagnai avec précipitation le cabinet de madame T…, et je me jetai, ou plutôt je tombai à ses pieds, car je ne pouvais plus me soutenir.
— Au nom de la charité, lui dis-je, un peu de vin pour se remettre, un peu de paille pour se reposer, à votre pauvre petit Adolphe ! Je meurs s’il faut que je passe encore cette nuit dans la neige !
Elle m’embrassa et pleura ; et comme ses larmes l’embellissaient ! Ensuite, elle me recommanda d’être prudent, et me conduisit dans une chambre écartée où il y avait trois lits. J’étais seulement prévenu que je n’avais rien à redouter de mes voisins. C’étaient des compagnons de malheur, mais je ne les connus pas ce jour-là. J’avais à peine achevé mon léger repas que tous mes sens furent liés par le sommeil. Quand je rouvris les yeux, il faisait jour.
Mes camarades m’embrassèrent en frères ; le nom de mon père ne leur était pas étranger. Nos sentiments étaient les mêmes ; notre fortune, notre destinée étaient communes ; ils m’offraient d’ailleurs quelque chose de plus que des consolations ; ils parlaient de grands dangers à courir, de quelque gloire à mériter. Ils voulaient changer mon sort, et j’étais jaloux déjà de partager le leur, quel qu’il fût.
L’amitié doit être un sentiment délicieux à toutes les époques et dans toutes les conditions de la vie ; mais, entre de jeunes âmes froissées par de nobles malheurs, c’est presque une religion.
L’un de ces messieurs avait dix-huit à vingt ans. C’était un jeune homme d’une figure affable mais sérieuse, plein de calme et de résolution, d’énergie et de présence d’esprit. Il s’appelait Forestier, et je crois qu’il était fils d’un cordonnier de Saumur ou de Cholet, je ne sais pas lequel. L’autre, qui avait pour lui la plus grande déférence, était de deux ou trois ans plus jeunes et se nommait le chevalier de Mondyon. Quoiqu’il fût tout au plus de mon âge, il était beaucoup plus développé que moi. Ma petite taille, mes yeux bleus, la couleur un peu ardente de mes cheveux bouclés, la fraîcheur d’un teint animé que je tiens de ma mère et qui caractérise nos Alsaciennes, me donnait, à mon grand regret, quelque chose de féminin et de timide qui m’avait souvent exposé, sur mon passage, aux soupçons et aux railleries des voyageurs mal élevés.
— En vérité, dit Mondyon avec un ton de gaieté expansive qui ne l’abandonnait jamais, nous aurons peine à persuader au général que ce nouveau camarade ne soit pas une jeune fille déguisée.
— Je le détromperai de cette erreur, lui répondis-je, sur le premier champ de bataille où il y aura du sang à répandre pour le service du roi.
Forestier sourit et me serra vivement la main ; Mondyon, qui craignait de m’avoir mortifié, me sauta au cou.